(Prof. Dr Bruno-J. TSHIBANGU Kabaji)
Introduction
Nous constatons que la Jeunesse constitue une couche importante de la population en RD Congo. Ce qui constitue une richesse pour notre pays parce qu’elle assure sa pérennité du point de vue démographique et son existence parmi tant d’autres pays. Car un pays sans une Jeunesse verte est voué à disparition. Mais, ce qui est important, est de savoir comment encadrer cette Jeunesse pour qu’elle soit utile au pays, qu’elle soit un moteur de développement durable dans le Corps politique. La considérer de manière générale ne permettrait pas à l’Etat qui doit la gérer de mieux s’y prendre.
Voilà pourquoi, il sied de la catégoriser pour que chaque éducateur s’occupe de l’encadrement de chaque catégorie de la Jeunesse. C’est ainsi que dans ce texte, nous devons chercher d’abord à montrer l’importance de la Jeunesse en général et de chacune de ses catégories dans la Société politique et le rôle qu’elle est appelée à jouer au sein de celle-ci. Ce rôle ne peut être bien joué que grâce à son encadrement efficace par l’Etat. Nous avons estimé qu’il faille un ou plusieurs modèles qu’elle doit imiter pour parvenir à bâtir une Société politique-type qui doit servir d’exemple aux autres. Une Jeunesse bien encadrée est capable de nous produire démocratiquement des représentants élus qui soient responsables et dignes.
Il existe un ministère qui s’occupe de la Jeunesse et de la citoyenneté en RD
Congo. Quels sont les objectifs que ce ministère s’est assigné dans l’encadrement de la Jeunesse, en général, et de la diversité d’autres Jeunesses, en particulier ? Comment encadre-t-il la Jeunesse intellectuelle en général ? A-t-il un programme précis conduisant à atteindre le changement de mentalité des Jeunes tout court ? En a-t-il des moyens ? Comment faire l’évaluation du niveau atteint dans l’évolution du changement de mentalité par des Jeunes, catégorie par catégorie ? Cette problématique est orientée vers l’Etat congolais et nous permet de fouiner et de proposer ce que nous estimons être utile pour le bien non seulement de la Jeunesse, mais aussi de tous.
1. L’importance de la Jeunesse dans un Etat Moderne
De quel type de Jeunesse voulons-nous parler dans ce texte ? Nous voulons parler
Ici de deux grandes catégories de la Jeunesse, à savoir la Jeunesse intellectuelle et la Jeunesse analphabète. La première catégorie est dite Jeunesse intellectuelle. Elle comprend en son sein une Jeunesse intellectuelle travailleuse et une Jeunesse intellectuelle désœuvrée (chômeuse). Et la seconde catégorie est dite Jeunesse analphabète. Elle comprend à son tour une Jeunesse analphabète débrouillarde, donc active et une Jeunesse analphabète non-occupée (chômeuse), donc passive.
L’importance de la Jeunesse, en général, dans l’Etat moderne dépendra de la catégorie à laquelle elle appartient et de la politique d’encadrement mise en ligne par les dirigeants politiques pour que toute cette Jeunesse se sente à l’aise.
Nous devons nous rappeler que du temps de Maréchal-Président Mobutu, nous parlions de la Jeunesse ouvrière, de la Jeunesse pionnière (Scouts, Kiros…), de la Jeunesse estudiantine et de la Jeunesse du Mouvement Populaire de la Révolution (JMPR). Cette façon de catégoriser la Jeunesse permettait au Gouvernement de tenter, tant soit peu, de s’assurer de son bon encadrement.
Pour notre part, nous nous devons de chercher, dans ce texte, une autre façon de la catégoriser pour que l’Etat congolais puisse trouver les voies et moyens d’atteindre de manière systématique, ordonnée et optimale l’ensemble de la Jeunesse, afin d’assurer au minimum son encadrement. C’est dans ce sens que nous avons esquissé la catégorisation ci-dessus présentée.
2. Jeunesse intellectuelle
L’importance de la Jeunesse intellectuelle dans une Société politique n’est pas à démontrer à cause de l’influence qu’elle exerce sur ladite Société, afin que celle-ci s’organise, se stabilise et se développe. Nous sommes certains que son poids numérique est très faible, mais son pouvoir de transformation a un impact social et politique redoutable sur toute société humaine. C’est grâce à son savoir-faire et son savoir-être et à a crédibilité que la Jeunesse tout entière peut être entrainée dans un mouvement violent ou non susceptible de conduire au changement politique et socio-économique dans la Société politique. La Jeunesse intellectuelle travailleuse demeure la clé de voûte pour le changement de mentalité et aussi le catalyseur du développement durable du pays.
Elle est en fait comparable à la sève qui nourrit une plante avec comme conséquence que sans elle la plante fane. Elle joue le rôle que joue le sang dans l’organisme humain. Cela veut dire que la Jeunesse est à l’Etat ce que la sève est à la plante et le sang à l’organisme humain. Ce qui veut autrement dire que sans la Jeunesse, le pays serait en panne sèche, donc fanerait comme une plante. En d’autres termes, si la Jeunesse, particulièrement intellectuelle, est corrompue, la Société politique dans laquelle elle vit, sera sans nul doute aussi corrompue et entièrement dépravée, nous vivrions, en effet, dans une société régressive.
Pour cela, certaines conditions s’imposent pour que la Jeunesse intellectuelle accomplisse sa mission de gardien de l’Etat de Droit et de Démocratie ainsi que celui du moteur de développement durable de la Société dans laquelle elle est appelée à évoluer. Pour qu’elle joue son rôle de bâtisseur, il faudrait qu’elle prenne conscience de la situation sociale, politique, économique et culturelle dans laquelle elle s’émeut et qu’elle agisse pour de manière à faire transformer les choses soit positivement soit négativement. Pour les désastres qu’elle peut potentiellement causer, l’Etat doit l’aider à se prendre en charge en vue de préserver le Bien-être intégral de tous.
Au regard de l’importance de la Jeunesse intellectuelle dans la Société, deux
Perspectives se dessinent. D’une part, si la situation de son pays est de nature à favoriser le Bien-être de tous, à favoriser la promotion des valeurs républicaines sur lesquelles est fondé l’Etat de Droit et de Démocratie, alors une telle Jeunesse sera tenue d’y participer, d’y concourir de manière que cette situation continue de s’améliorer davantage avec le concours de l’Etat ; d’autre part, dans le cas échéant, si l’Etat est défaillant, cette Jeunesse est appelée à lutter pour changer cette situation on ne peut inhumaine en une situation plus humaine. Cette fois-ci, elle doit adopter constitutionnellement la non-violence comme méthode de lutte, méthode de combat pour l’Instauration de l’Etat de Droit, libre et démocratique dans son pays. Une telle lutte est suscitée surtout si le Peuple se retrouve devant un Pouvoir politique sourd et muet.
Pour passer ainsi des conditions moins humaines dans lesquelles vivoterait le Peuple, aux conditions plus humaines dans lesquelles pourraient vivre calmement ce Peuple, il serait impérieux de tout faire pour que celui-ci, en général, et la Jeunesse intellectuelle, en particulier, prennent conscience en amont de leurs conditions de vie inhumaines et qu’ils prennent courageusement la décision de les changer en conditions de vie humaines en vue du changement radical de mentalité recherché. Ce combat de démocratisation des Institution ou de libération interpellerait à coup sûr l’Etat et lui permettrait d’y répondre positivement.
Aussi, lui arrivera-t-il de lutter avec l’ensemble des contestataires pour l’extirpation des antivaleurs qui joncheraient l’esprit de la plupart des Jeunes intellectuels de manière particulière.
Nous nous devons ici de souligner que cette prise de conscience présage le changement progressif de mentalité et exige de la Jeunesse intellectuelle la compréhension de la situation globale que traverse le Corps politique. Si le pays baigne dans la catastrophe sociale et politique, cette Jeunesse doit s’interroger sur la cause première de cette catastrophe que subit le Peuple et doit chercher, par conséquent, les voies et moyens pour l’éradiquer. Si la cause première est, par exemple, la mauvaise gouvernance, il y a moyen de l’attaquer et de rappeler énergiquement les gouvernants à plus de transparence dans la gestion afin d’améliorer les conditions de vie de la grande majorité du Peuple. En ce moment-là, il ne restera plus qu’à voir comment transformer progressivement l’homme afin de maintenir le rythme de vie dans lequel continuera à vivre le Peuple.
Pour y arriver, la population déjà conscientisée, fidélisée et guidée par l’intellectuel sera tenue d’accompagner l’Etat dans la réalisation du Bien-être de tous. Devant un Pouvoir autocratique réfractaire au changement, les discours des hommes révoltés ayant déjà conscientisé la majorité du Peuple s’imposent nécessairement pour obliger ce Pouvoir à se raviser en faisant la volonté générale. Avant que l’attaque d’un Pouvoir dictatorial ne soit déclarée, elle devra être précédée en amont par un Plan stratégique anticipatif à long terme détaillant toutes les étapes devant conduire à la victoire sur ce régime ‘’peuplecide’’. Ce Plan doit tenir compte des rapports de forces déjà évalués. C’est le résultat de ces rapports de forces qui pourra vous dicter le genre des méthodes auxquelles vous devez recourir pour bien mener cette lutte de libération ou de démocratisation du Corps politique. Si vous optez pour la non-violence avec le dialogue comme cheval de bataille alterné par l’usage des différents procédés de cette méthode notamment la désobéissance civile, les marches pacifiques dans la rue, les dénonciations faites à travers des communiqués de presse, des déclarations politiques, des mises au point et consorts, seront de mise.
C’est en ce moment-là que le rôle de la Jeunesse intellectuelle en tant que
cerveau-moteur du Corps politique apparait politiquement au grand jour : après avoir compris pourquoi la lutte de libération est engagée, elle s’engage, elle aussi, à conscientiser toute la population, en général, et toutes les autres Jeunesses, en particulier, pour que celles-ci soient associées aux actions qui doivent être menées pour exiger, entre autres, le changement du régime jugé barbare et/ou autoritaire, sourd et/ou muet en un régime capable de booster le développement durable du pays en commençant par privilégier l’agriculture, la pêche et l’élevage sans jamais négliger les autres secteurs de la vie nationale.
Une fois qu’elle ait pris conscience des mauvaises conditions dans lesquelles vit la population, la Jeunesse intellectuelle doit passer aux différentes actions de lutte comme annoncées ci-dessus. C’est en ce moment-là qu’elle va montrer qu’elle demeure le moteur du changement politique et socio-économique dans sa Société. Nous n’avons qu’à voir comment elle se déploie sur la rue à l’appel d’un Leader charismatique comme du temps de Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Autrement dit, vous trouverez qu’au cœur de toutes les manifestations pacifiques de lutte pour le changement politique et socio-économique dans le Corps politique, la Jeunesse à plus de 60% y occupe une place prépondérante par rapport à la participation des adultes ou des vieux, simplement parce qu’elle a non seulement de la vigueur, mais aussi parce qu’elle a déjà compris que son avenir doit être préservé contre les caprices des hommes politiques sans conscience claire, et doit être préparé en vue de s’assurer de son Bien-être intégral durant toute la durée de sa vie.
Il faudrait donc prévenir ceux qui veulent libérer le pays de la dictature ou d’une autre forme d’asservissement ou d’esclavagisme que plusieurs d’entre les pionniers peuvent se présenter comme des Leaders. Pas de soucis. Mais l’histoire de lutte de libération montre qu’au fur et à mesure que la lutte dure dans le temps, un véritable Leader surgira du lot. Nous devons ici affirmer que le Leader ne se choisit pas, ne se déclare pas, ne se décrète pas, il émerge du lot grâce à son endurance, à sa constance dans la poursuite de l’Idéal déjà fixé.
D’où l’affirmation osée selon laquelle il n’y a jamais eu plus d’un Leader dans un groupe ; il n’y en a qu’un seul et les autres devraient s’aligner derrière celui-là formant ainsi une file indienne. Les exemples sont légion pour illustrer cette affirmation : Gandhi en Inde, Mandela en Afrique du Sud, Lumumba, puis Tshisekedi en RD Congo, Modibo Keita au Mali, Kwame N’Nkrumah au Ghana, Sekou Touré en Guinée, et consorts. A chaque situation politique prônant donc la confiscation des libertés humaines à une époque donnée de l’histoire surgit nécessairement un Leader, un homme providentiel capable de s’affronter aux prédateurs pour les faire agenouiller et faire libérer ainsi les Peuples de la servitude.
En ce qui concerne Tshisekedi Etienne, celui-ci fit partie de 13 Parlementaires signataires de la Lettre de 52 pages et qui sont à l’origine de la création de l’UDPS en février 1982. Ils ont recruté d’autres opposants politiques pendant la période de la clandestinité. Ce qui a porté le nombre des Fondateurs de l’UDPS à 18. De tous, il n’y a que lui, Etienne Tshisekedi, qui s’est distingué dans la lutte jusqu’à sa mort devenant ainsi le Leader charismatique de l’UDPS, l’incarnation de l’opposition congolaise et Opposant historique aux régimes dictatoriaux qui se sont succédé en RD Congo. Les autres Fondateurs sont tombés pour telle ou telle raison abandonnant ainsi la lutte et rejoignant tel ou tel parti présidentiel ou en créant un parti proche du Président de la République en place ou cédant à l’oppression du Pouvoir en place.
Nous avons longtemps épilogué sur la Jeunesse intellectuelle travailleuse sans faire allusion à la Jeunesse intellectuelle désœuvrée. Celle-ci, à son tour, vit ses réalités propres dans la Société. Elle a une autre lecture de l’avenir de son pays. Fière d’avoir étudié et décroché son diplôme scolaire ou académique, elle se retrouve chômeuse ! D’où une certaine frustration qu’elle ressent dans sa Société par rapport aux autres Jeunes intellectuels confortablement traités ou même par rapport aux aventuriers analphabètes qui ont réussi, chacun, sa vie par aventure, ou à travers les relations particulières qu’entretient chacun avec une autorité influente du Pouvoir en place.
A ce sujet, pour se défouler ou laver ce qu’elle pourrait avoir considéré comme un affront, elle pourrait se dresser contre le Pouvoir existant considéré comme le prophète de son malheur. Voilà pourquoi cette catégorie de la Jeunesse adhère parfois naïvement ou par esprit de vengeance aux avances lui faites par l’opposition politique ou armée surtout dans un pays où la misère bat son plein et la volonté politique du Pouvoir politique y est quasiment absente. Elle se nourrit d’espoir que lorsque le régime politique change, elle pourrait se retrouver en bonne position dans le nouveau régime.
La Jeunesse intellectuelle désœuvrée est pire qu’une Jeunesse analphabète inoccupée. A cet effet, l’expérience renseigne que le rôle généralement joué par une telle Jeunesse dans la Société est en grande partie nuisible que celui joué par une Jeunesse analphabète inoccupée. Cela dans la mesure où avec son esprit d’ouverture et inventif, elle serait à même de révolter facilement la population pauvre et misérable contre les Institutions légalement établies, de changer ou d’influencer négativement la mentalité de celle-ci parce mécontente de la situation de misère dans laquelle elles baigneraient toutes.
Le rôle de la Jeunesse intellectuelle désœuvrée dans la Société politique ressemblerait à celui du poison dans l’organisme humain. Connaissant probablement le pourquoi de ces conditions de vie inhumaines dans lesquelles elle baignerait avec le peuple, dans sa mauvaise foi ou dans son désespoir, elle pourrait refuser de dire la vérité à celui-ci afin de lui donner un peu d’espoir de vivre. L’objet final recherché étant de le révolter davantage contre le Pouvoir en place qu’il accuse d’être son porte-malheur espérant par-là qu’en le combattant, sa vie pourrait un jour changer positivement si jamais le régime, pour lui, avilissant parvenait aussi à être changé.
3. Jeunesse Analphabète
Une Jeunesse Analphabète peut trouver une occupation lucrative dans une entreprise ou faire du commerce. Par conséquent, elle peut devenir responsable dans sa vie quotidienne. Dans le régime Mobutu, cette Jeunesse constituait ce que l’on avait autrefois dénommé Jeunesse ouvrière. Une fois occupée lucrativement, elle devient utile à sa Société parce qu’elle pourrait se préoccuper et de son avenir et de l’avenir de sa famille et par ricochet celui de la Société même.
Si la Jeunesse analphabète travailleuse est bien sensibilisée par une Jeunesse
intellectuelle digne de ce nom, une Jeunesse responsable, patriote et nationaliste, qui lui fait voir celui qui est responsable de sa pauvreté, de sa misère et comment faire pour changer la méthode de gouvernance du Pouvoir prédateur ou le pousser à la sortie, une telle Jeunesse pourrait facilement se décider de commencer à participer aux actions jugées par lui salvatrices initiées par le camp de l’opposition politique si celle-ci est réellement responsable des actes qu’elle pose ; ou alors, dans le cas de force majeure recourir à la violence pour faire changer le régime de misère en régime salutaire.
A contrario, une telle Jeunesse non formée sur le plan intellectuel et moral peut devenir nuisible à l’avancement du pays dans la mesure où elle peut aussi être facilement corrompue, instrumentalisée, manipulée par ceux qui sont au Pouvoir pour jouer au statu quo, donc jouer à la protection du régime honni par la majorité du Peuple. C’est souvent le jeu politique des renégats récupérés de l’ancien régime grâce à leur expertise avérée dans tel ou tel domaine de la vie nationale. C’est le cas actuel des anciens collaborateurs des régimes Mobutu et J. Kabila approchés, après fidélisation, par le régime Tshisekedi, pour rendre service à la Nation. Il est un constat amer que la plupart d’entre eux demeurent nostalgiques à Mobutu et les autres ont leur cœur à Joseph Kabila. Surtout en ce qui concerne les officiers de FARDC et ceux de la PNC ainsi que les cadres de service de renseignement.
S’agissant d’une Jeunesse analphabète non-occupée, donc chômeuse, la situation devient encore pire. Etant chômeuse, cette Jeunesse demeure potentiellement capable de devenir extrêmement dangereuse pour la Société à laquelle elle appartient. Car il ne lui reste, pour survivre, qu’à voler, qu’à s’emparer des biens des autres, qu’à tuer si possible, qu’à semer la terreur et la désolation dans le chef de la population dans le but simplement de satisfaire à ses besoins naturels, à la dictée de son cœur. C’est ainsi que nous avons des kulunas à Kinshasa, des shegues à Lubumbashi, des Wayambards à Likasi, des Suicidaires à Mbujimayi, et consorts. Ce sont des voyous de toutes sortes qui se retrouvent à travers la République incarnant la délinquance juvénile caractérisée par des larcins, des vols, des assassinats, comme dit ci-dessus. C’est un phénomène social renforcé par le manque d’encadrement. Cette catégorie de la Jeunesse analphabète désœuvrée pose énormément de problèmes à la population et particulièrement à l’Etat congolais qui semble ne pas trouver une solution appropriée pour y mettre définitivement fin.
Dans la recherche des solutions pour mettre fin au phénomène kuluna ou réduire, tant soit peu, son expansion et influence, le Gouvernement de la RD Congo a réussi à faire de quelques-uns d’entre eux des bâtisseurs de la Nation. A Kinshasa, par exemple, ils ont été arrêtés et expédiés à Kanyama Kasese, dans le Haut Lomami, pour s’occuper des travaux champêtres, de la menuiserie, maçonnerie. Ils sont nourris et payés comme tout employé de la Fonction Publique. Ils s’y sont adaptés et n’envient absolument rien à leur vie de vadrouille. Ils se sont bien intégrés dans la vie sociale. Ce qu’ils considéraient au départ comme corvées est devenu à ce jour un véritable emploi rémunérateur. A Kolwezi, dans la province de Lwalaba, une initiative de ce genre a été prise par le Gouvernement provincial. Nous estimons que les autres Gouvernements provinciaux pourraient leur emboiter les pas pour réduire la progression de ce phénomène social très nuisible à la Société.
Il serait seulement souhaitable qu’un budget annuel conséquent soit alloué à ce genre d’initiatives au ministère de la Jeunesse et Nouvelle citoyenneté pour protéger, tant soit peu, la population contre les tracasseries de cette catégorie de la Jeunesse analphabète nonoccupée pour leur encadrement.
Au regard de ce qui précède, il apparait nettement que le rôle de la Jeunesse, en général, devient problématique et complexe ici en RD Congo. Si une Jeunesse analphabète désœuvrée est majoritaire par rapport à la Jeunesse intellectuelle consciente, comme c’est le cas dans notre pays, les actions de délivrance de ce pays des mains des prédateurs, par un choix judicieux de ses représentants dans les organes délibérants, par exemple, devient dubitatif et même catastrophique, car le choix des dirigeants sera aléatoire, donc conforme à la volonté de cette catégorie des populations au cas où elle participait massivement au vote.
Pour être clair, nous nous devons d’illustrer cette thèse par ce qui se passe dans les Etats postcoloniaux en Afrique centrale, en général, en RD Congo, en particulier. Notre pays regorge majoritairement plus de 60% de Jeunes, toutes catégories confondues, sur les 100% de la population totale. Ce qui fait que cette Jeunesse, pour la plupart illettrée, manipulable et inexpérimentée, constitue l’essentiel de l’électorat de la plupart de l’Etat congolais à aspiration moderne.
La conséquence de cet état de chose demeure que la plupart des délégués élus par cette Jeunesse ne sont pas souvent compétents, matures et efficaces sur le terrain, afin de rendre du bon service à la Nation. Ils dirigent vaille que vaille les Etats sous leur responsabilité reflétant l’image de leurs électeurs. Voilà pourquoi les Occidentaux luttent pour maintenir les Jeunes africains dans l’ignorance. A ce sujet, nous avons constaté que ce n’est pas pour rien que les comédiens, les musiciens, et ceux qui les imitent sans oublier ceux qui les défendent et les amusent, lors des campagnes électorales, sont généralement les mieux élus que ceux qui s’efforcent à présenter aux électeurs leurs projets de société très bien élaborés, structurés et mûris.
Sur le plan politique, l’influence de la Jeunesse se fait sentir aussi bien dans des partis politiques en lutte pour l‘instauration de l‘Etat de Droit et de Démocratie que dans la Société civile engagée pour la cause du plus grand nombre. Voilà pourquoi P. Leroy-Beaulieu remarque que « si l’on tient compte, en outre, de ce que, dans les pays, les partis politiques en lutte ne sont séparés que par un nombre assez restreint de suffrages, on en peut conclure que la partie la plus jeune et la moins expérimentée de la nation se trouve, chez les peuples modernes, en possession réelle de la conduite des affaires » (P. LEROY-BEAULIEU, 1888 )
C’est cette Jeunesse, en majorité inexpérimentée, qui est le moteur du changement politique, l’avons-nous dit, dans la plupart des Etats africains. C’est elle qui participe parfois inconsciemment aux actions de rue, à la désobéissance civile, aux grèves et menaces contre les régimes en place considérés, à tort ou à raison, comme nuisibles aux intérêts du plus grand nombre de citoyens.
Généralement, les Leaders, pour la plupart des prébendiers, leur font des promesses quasi-irréalisables auxquelles la grande partie de cette Jeunesse croit naïvement.
Parfois ces Leaders, toutes tendances confondues, se révélant incompétents et inconscient pour la plupart d’entre eux, ne savent pas expliquer les sens de certains concepts importants qui justifient leur lutte de libération ou même répondre à la question de pourquoi ils veulent devenir, entre autres, des députés ou des sénateurs, des ministres ou des mandataires publics.
Nous nous souvenons, en 1960, ici en RD Congo, comment certains de nos Pères de l’indépendance tentaient d’expliquer à la population le sens du concept d’indépendance, par exemple. Pour quelques-uns d’entre eux donc, l’indépendance signifierait le remplacement des Blancs par les Congolais partout où ils travaillaient, partout où ils vivaient notamment dans leurs maisons, dans leurs bureaux, dans l’Armée et dans la Police. Nous allons occuper leurs postes et exercer les fonctions qu’ils occupaient, prendre leurs femmes et leurs biens de valeur si nous parvenions à les faire partir !
La Démocratie, quant à elle, était le droit de tout faire, était l’usage illimité des libertés (libertinage), faire ce que l’on veut sans aucune restriction ; ce qui reviendrait à dire que l’on pouvait injurier quelqu’un au mépris de la loi, faire pipi en public, s’habiller n’importe comment, spolier les biens d’autrui tant que l’on est plus fort que l’autre, taper sur la Police de Surveillance Routière (PSR) ou autre, par exemple ; alors que ce n’était pas cela les sens de ces concepts cités au hasard parmi tant d’autres ! Connaissaient-ils au fond les sens véritables des concepts d’indépendance et de démocratie ou ils le faisaient de manière stratégique pour motiver la population à honnir les Blancs, à revendiquer l’indépendance et obtenir son adhésion à la lutte pour les chasser du territoire national et atteindre ainsi leur objectif, celui de libérer le pays du joug colonial. Si c’est cela tant mieux ! Si c’est le contraire, ce serait regrettable.
Quant à l’aspect socio-économique, la relève dans les entreprises était une question d’une Jeunesse intellectuellement bien formée, une Jeunesse qui aimait le travail bien fait, une Jeunesse qui voudrait produire pour la communauté et pour elle-même en vue du développement de son pays. Mais la production était une affaire et de la Jeunesse intellectuelle travailleuse et de la Jeunesse analphabète employée comme ouvrière, de toute la population.
L’aspect social bien que lié à l’économique apparaissait surtout dans chaque famille où l’on constatera que la direction de celle-ci devenait pour la plupart des cas l’affaire d’un Jeune enfant qui aura déjà atteint un âge acceptable par les parents. Ces Jeunes y jouaient ainsi le rôle prépondérant aux côtés de ceux-ci. Dans le même sens que nous, P. Leroy-
Beaulieu a fait le constat suivant : « On sait que dans la famille moderne, ce n’est pas le père qui dirige l’enfant adulte, mais ce dernier dirige son père (…) » (P. Leroy-Beaulieu, 1888). Il nous parait que c’est un phénomène naturel parce que vécu depuis la nuit de temps aussi dans des villages africains et se poursuit jusqu’à ce jour.
Sur le plan culturel, la ‘’véhiculation’’ des valeurs tant morales, chrétiennes que démocratiques ; et le respect de la tradition africaine, en général, et congolaise, en particulier, étaient la priorité d’une Jeunesse dorénavant bien éduquée, bien formée et bien informée pour accomplir une telle mission on n’en peut plus républicaine ; or, la majorité de cette Jeunesse était analphabète. Il fallait donc qu’un grand effort soit consenti par l’Etat pour que cette difficulté soit surmontée pour la meilleure ‘’véhiculation’’ des valeurs constructives de notre Société politique.
Ainsi, l’importance de la Jeunesse peut se résumer dans la pensée qu’elle demeure la sève de la Nation, l’avenir de demain. Mais, de quelle Jeunesse s’agit-il ici ? Il est question d’une Jeunesse potentiellement éducable, une Jeunesse capable d’observer le sens d’honneur, de dignité et de responsabilité partout où elle se rencontre et qui peut se rencontrer surtout dans la Jeunesse intellectuelle et dans la Jeunesse analphabète travailleuse. Chaque catégorie rendant service à la Nation à son niveau.
L’éducation renvoie au bon encadrement de la Jeunesse, à sa meilleure formation, c’est-à-dire, à une formation assurée en fonction de l’Idéal que le Gouvernement de la République s’est fixé, à savoir former une Jeunesse capable de contribuer, par exemple, à l’instauration de l’Etat de Droit et de Démocratie, à la bonne gouvernance et aussi capable d’appuyer les efforts du Gouvernement dans la matérialisation de son Plan National Stratégique du Développement. C’est dans la matérialisation de ce Plan Stratégique que la RD Congo se verra complètement transformée.
Pour cela, le Pouvoir politique, par le biais de son Gouvernement, devra avoir une Vision politique stratégiquement anticipative de ce que sera la Jeunesse selon sa catégorie, dans tel ou tel domaine et dans autant de temps à venir. Le problème pourrait se poser sans doute quant à la grande frange de la Jeunesse d’aujourd’hui qui a été délaissée pendant plus d’une soixantaine d’années sans une formation précise en vue d’un objectif éducatif préalablement fixé. C’est cet objectif qui devrait être atteint en sa faveur par les différents Gouvernements qui se sont succédé en RD Congo.
Comment faire de telle sorte que la Jeunesse puisse rattraper la base éducative déjà manquée, parce qu’elle serait potentiellement à mesure d’influencer négativement l’éducation de la Jeunesse actuelle et pourrait offusquer indubitablement l’Etat à atteindre ses objectifs ? Si nous n’y prenons pas garde, il y aurait risque de tourner en cercle vicieux dans le projet d’encadrement de la Jeunesse.
Le Gouvernement de la République doit mettre du paquet non seulement dans la formation en général, mais aussi dans le domaine de l’éducation-rattrapage ou de la mise à niveau à partir de la famille et de l’école, des Jeunes mal éduqués ou en manque d’éducation. L’Etat qui est l’agent principal de l’éducation doit trouver les mécanismes d’assainissement du climat environnemental, afin que les enfants et la Jeunesse se promènent dans un environnement sain dans le respect de cette pensée : l’esprit sain dans un corps sain. Cela est possible si la volonté politique y est ; or la volonté politique est manifeste dans le Chef des gouvernants, donc cet objectif peut être atteint. Le plan National stratégique pour l’encadrement de la Jeunesse qui doit être conçu à cet effet doit ainsi inclure cette dimension.
Dans le processus de réalisation de l’Idéal de voir naître dans notre pays une
Jeunesse, dans l’ensemble, bien formée, bien éduquée, il faudrait y associer une Jeunesse intellectuelle distinguée ou des adultes capables de l’encadrer en vue de participer à sa formation. Ces éducateurs doivent être transformés en bras séculier du Gouvernement qui est censé incarner l’idéal à atteindre.
Le Gouvernement de la République a le devoir d’associer ces Jeunes intellectuels progressivement à la gestion de la chose publique à partir de la base. Ce qui nous éviterait la question déroutante et décourageante liée à ce que l’on appelle couramment le manque d’expérience lorsqu’on voudrait être engagé dans le jour à venir, argument devenu un prétexte séditieux et spécieux lorsque l’on voudrait engager un Jeune au service.
4. Jeunesse et son Modèle en RD Congo
La Jeunesse doit avoir un Modèle à suivre parmi les dirigeants, car elle ne pourrait valoir que ce qu’a valu ou vaut son Modèle malgré le Plan Stratégique de l’Education dont le Gouvernement peut disposer. Une jeunesse sans Modèle est comparable, selon nous, à un avion sans boussole, à une leçon sans matériel intuitif.
Nous devons ici comprendre que le Modèle d’homme que nous recherchons pour proposer à la Jeunesse ne sera pas un ange, donc un homme parfait ; car, tout être humain est naturellement caractérisé par des imperfections, des faiblesses et aussi des forces morales et spirituelles. Mais, il est cependant perfectible, c’est-à-dire capables de s’élever au-dessus du commun des mortels en aspirant à devenir meilleur que les autres humains, en abandonnant son passé odieux pour devenir un homme nouveau. Il peut avoir été un brigand, un assassin, un impudique, un cupide, un détourneur des deniers publics ; mine de rien, il prend conscience et décide d’abandonner toutes les antivaleurs pour devenir le donneur de leçon au peuple, un combattant de la Liberté, un apôtre de la paix, prêchant ainsi le changement de mentalité afin de mener à bon port sa lutte de la libération de ce Peuple du joug quelconque.
Ce changement de mentalité apparaît surtout dans le secteur politique qui est un secteur pilote par rapport aux autres secteurs de la vie nationale. C’est ainsi qu’en présentant P.E. Lumumba et E. Tshisekedi comme Modèles de la Jeunesse congolaise, nous ne voulions pas dire qu’ils étaient immaculés dans leur vie. Voilà pourquoi, nous avons eu à brosser l’autre face de chacun de ces deux Leaders en plus de leur face élogieuse.
Politisée et instrumentalisée en RD Congo depuis le régime de Mobutu jusqu’au régime de Joseph Kabila en passant par celui de L.D. Kabila, la Jeunesse avait déjà perdu les sens de responsabilité, d’honneur, de dignité, du patriotisme et du nationalisme. Corrompue, molle et apathique en sa majorité, elle s’est mise de manière contraignante et inconsciente au service des dictateurs, afin que ceux-ci s’appuient sur elle et s’adonnent à cœur joie à torpiller les aspirations profondes du Peuple qui pourtant espérait ardemment en elle. C’est avec la création des partis d’opposition que la Jeunesse congolaise fut mobilisée derrière l’Idéal de combat, à savoir : l’instauration de l’Etat de Droit et de Démocratie dans son pays. Elle s’est rendue compte qu’elle était en état de sommeil profond et qu’il était temps, pour elle, de se réveiller et de commencer la lutte pour la conquête de ses libertés et droits fondamentaux ainsi que du Bien-être intégral de tous.
Il avait fallu, à cet effet, que Feu Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba,
Président National de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS en sigle, premier parti politique d’opposition ayant remis en cause la gouvernance du MaréchalPrésident, et Leader historique de l’opposition congolaise, prenne conscience du « mal zaïrois » et décide de l’enrayer. C’est grâce à son leadership éclairé incontestable que le Peuple, en général, et la Jeunesse, en particulier, a pu prendre aussi conscience et se réveiller pour affronter la dictature mobutienne, la plus abjecte de l’Afrique.
Il sied de rappeler qu’à l’époque, une Jeunesse qui voyait autrement et de manière critique la politique du Gouvernement était étouffée dans ses initiatives, réprimée lorsqu’elle tentait de faire des actions de la rue ou des dénonciations politiques ; ses Leaders bâillonnés au point de les arrêter et de les emprisonner. Les Pouvoirs autocratiques, comme celui de Mobutu, de L.D. Kabila et de J. Kabila, s’employaient à décourager une Jeunesse qui devrait pourtant être une lumière qui luit dans les ténèbres, un architecte du lendemain meilleur en tant qu’elle est la sève de la Nation ; une Jeunesse qui devrait d’ailleurs être au service du développement durable, pour ne défendre qu’un Pouvoir manipulateur qui affamait et appauvrissait impitoyablement le peuple ;un Pouvoir qui ne pouvait qu’autoriser les manifestations pacifiques que celles organisées dans l’intérêt du Pouvoir existant.
Ce qui faisait par conséquent d’une telle Jeunesse, une Jeunesse aveugle,
amorphe, corrompue, indigne et irresponsable, une Jeunesse incapable de se battre pour un avenir meilleur de son pays et d’elle-même parce que manipulée à souhait pour défendre les intérêts de la classe dirigeante, pourtant une Jeunesse dans laquelle le peuple tout entier avait placé et sa confiance et son espoir, parce que considérée comme le fer de lance du changement radical du système déshumanisant, comme la sève qui nourrit l’Etat pour que celui-ci nourrisse le peuple, afin que ce peuple ne fane comme fanerait une plante sans sève. Nous n’avons qu’avoir, chez nous en Afrique, la bonne réputation dont bénéficient les jeunes étudiants de la part de leurs parents lorsqu’ils rentraient en vacances dans leurs villages. Avec la confiance qu’on leur faisait, ils pouvaient changer la mentalité de la population de leurs propres cités.
Voilà pourquoi, une telle Jeunesse a besoin d’un Modèle ou des Modèles du combat pour se libérer du joug quelconque. Dans ce livre, nous proposons à la Jeunesse congolaise P.E. Lumumba et E. Tshisekedi. Les deux figures de proue qui font et continuent de faire l’honneur de la RD Congo pour leur combat historique et opiniâtre dans la construction d’un Congo de Droit, de Liberté et de Démocratie. Ils prirent, chacun à son époque, conscience des conditions de vie inhumaines dans lesquelles le peuple congolais vivait : l’un contre la colonisation et l’autre contre la dictature. Ils prirent conscience de ces conditions de vie horribles et décidèrent de lutter, chacun, pour les transformer en des conditions de vie heureuses pour l’ensemble de la population. Ils recoururent, chacun à son époque, à l’efficacité de la non-violence comme méthode de combat de libération.
A l’instar de Lumumba et Tshisekedi, la Jeunesse doit comprendre que la prise de conscience est une étape essentielle lorsqu’il faudrait libérer un peuple meurtri par un oppresseur. Elle doit savoir qu’après avoir pris conscience, la Jeunesse doit comprendre qu’une telle lutte doit être inscrite dans l’espace et non dans le temps, car l’on connaît quand elle commence et point quand elle termine, et on ignore même en faveur de qui elle va terminer. L’on s’y engage en toute opiniâtreté et au nom de l’Idéal, pas pour des intérêts mesquins et individuels.
En ce qui concerne la RD Congo, le Président de la République, Chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait de l’éducation de la Jeunesse sa préoccupation majeure. Voilà pourquoi il a institué la gratuité de l’enseignement et a amorcé le combat contre la délinquance juvénile en orientant certains d’entre les Jeunes vers les secteurs professionnels et des métiers. Toutes ces initiatives sont prises en vue de préparer à long terme la matérialisation effective de l’Etat de Droit et de Démocratie dans notre pays. Nous parlons d’une lutte dans la mesure où certains Congolais ignorant l’importance de vivre-ensemble dans un Etat de Droit et de Démocratie se permettent de combattre son avènement uniquement dans le but de protéger cyniquement leurs intérêts égoïstes ; tout comme il existe des étrangers qui, voulant voir l’anarchie et le cafouillage continuer à régner en leur profit, se mettraient à empêcher la naissance d’un tel Etat.
L’essentiel pour la Jeunesse congolaise devrait consister à accompagner le chef de l’Etat dans ses efforts pour la matérialisation progressive de cet Idéal en faisant respecter la Liberté, la Justice et la Croissance, trois piliers qui soutiennent cet Idéal démocratique tout au long de sa gouvernance. Elle doit éviter de se faire corrompre par des discours malveillants, insidieux et spécieux prononcés par certaines autorités religieuses et politiques qui s’enrichissent illicitement et sans pitié au détriment de leurs fidèles ou de leurs militants oubliant ainsi leur mission pastorale et politique. Il s’agit particulièrement des Leaders de certains partis politiques dits de l’opposition en mal de positionnement qui ne se servent que des mensonges et des désinformations visant à mener une mauvaise propagande contre la marche positive et progressive du Pouvoir politique vers le développement du pays.
La Jeunesse congolaise doit donc comprendre que ce qui manquait à notre pays, c’était un homme qui a une Volonté politique manifeste à sa tête. Pour le moment, le Président Tshisekedi Tshilombo, par ses réalisations dans si peu de temps, affiche clairement et en toute évidence ce profil longtemps recherché. A sa prise du Pouvoir, il a trouvé un pays enfoui dans un fossé d’une profondeur incommensurable, travail de destruction de plus de 50 ans d’âge fait par ses prédécesseurs. Il s’est mis à l’œuvre pour jeter des jalons à partir desquels le pays pourrait décoller quant à son développement. Vouloir qu’un pays détruit sauvagement par un bon nombre de dirigeants politiques inconscients soit réhabilité en cinq ans d’exercice du Pouvoir est un non-sens. Nous sommes persuadés qu’avec sa Volonté politique déjà affichée ainsi qu’avec la détermination de la Jeunesse, le Président Tshisekedi pourrait déjouer tous les pronostics en sa défaveur.
5. Les Tâches des Agents de l’Education
Pour parvenir à une Jeunesse de cette importance, la grande tâche incombe essentiellement à l’Etat congolais. La famille, l’école, l’église et l’environnement viennent en arrière-plan. L’Etat doit améliorer les conditions de vie des parents pour qu’enfin de compte ceux-ci s’occupent dignement et de manière responsable de l’éducation de leurs enfants.
A ce niveau précisément, nous nous devons de féliciter la Volonté politique manifeste du Président de la République, Chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de son Gouvernement, pour avoir fait de la gratuité de l’enseignement de base une réalité incontestable et pour les efforts entrepris encore pour la concrétisation du projet de la Couverture Santé Universelle afin de soulager, tant soit peu, une des dimensions sociales qui handicape sérieusement le train de vie de la population.
Signalons ici le cas d’une Jeunesse qui a raté son éducation de base et qui est devenue dangereuse pour la société. Il s’agit du phénomène « Kuluna » à Kinshasa et qui se manifeste partout en RD Congo sous différentes appellations. Ce cas a retenu notre attention particulière. Nous louons à ce sujet l’initiative du Président Tshisekedi et de son Gouvernement pour avoir transformé ces jeunes délinquants en bâtisseurs pour la République, pourtant une main-d’œuvre qui pourrissait faute d’un employeur conséquent et surtout par manque d’imagination des Pouvoirs précédents. Les gouverneurs de provinces doivent emboiter le pas au Pouvoir central comme nous l’apprenons en ce qui concerne l’initiative prise dans la province de Lwalaba par la Gouverneure de province Fifi Masuka.
A ce sujet encore une fois, nous jetons des fleurs au chef de l’Etat Tshisekedi pour son souci permanent de mieux-faire pour l’amour de la population en cherchant à endiguer ce fléau social. Cette volonté se manifeste aussi dans d’autres domaines de la vie nationale à travers un bon nombre de projets de développement tels le projet de développement local de 145 Territoires de la RD Congo, le projet de production de gaz et de carburant à partir de l’hydrogène (H2), la chasse aux détourneurs des finances de l’Etat et aux maffias nationales et internationales qui privent l’Etat congolais de ses ressources et moyens pour réaliser l’ensemble de ces projets de développement en faveur de la population, en général, et de la Jeunesse, en particulier.
Nous avons parlé d’une Jeunesse délinquante déjà récupérée ou encore en train d’être récupérée pour l‘intérêt de la Nation. Quant à la Jeunesse diplômée, donc fruit de l’école et de la famille, l’encadrement de l’Etat congolais s’impose en lui donnant du travail. S’il n’en a pas et parce qu’il a déjà investi en elle, au lieu de la laisser chômée de peur d’enregistrer encore des « Kuluna » en cravate qui seront pires que les premiers, il doit disposer d’un budget conséquent pour pouvoir assurer la survie de cette Jeunesse selon une périodicité à convenir. Sinon, il ne servira à rien de continuer à former par milliers de Jeunes que l’on ne sait pas finalement encadrer. D’ores et déjà, nous ne cessons de féliciter la clairvoyance du Président Tshisekedi pour l’effort fourni en nommant par-ci par-là un bon nombre de Jeunes diplômés à la tête de certaines entreprises publiques et de la petite territoriale du pays.
Tout cela ne suffit pas parce qu’il ne s’agit là que de la dimension physique et matérielle de la population. Or, il faille que l’Etat prenne au sérieux la dimension morale et spirituelle de son peuple en travaillant pour le changement de mentalité. Car celui-ci fonde et guide la dimension matérielle de l’être humain. Une dimension qui doit avoir une part grandiose dans le Plan Stratégique de l’Education de la Jeunesse et qui doit constituer un Effet Final Recherché.
6. Vers un Nouvel Homme Congolais
Dans sa majorité, la population congolaise a intériorisé les antivaleurs devenant ainsi ses valeurs propres ! Mais, il faut former un Nouvel Homme Congolais. Voilà une tâche qui incomberait à l’Etat congolais. Il doit chercher par tous les moyens comment créer un «
Nouvel Homme Congolais », donc un « Nouveau Congolais » que les chrétiens appelleraient
« Né d’eau et d’esprit » en procédant par le changement de mentalité. C’est encore un autre Effet Final Recherché, un Effet à atteindre et qui doit constituer un point à développer dans le
Plan Stratégique de l’Education de l’Enfant et de la Jeunesse. Ainsi, ce nouveau Congolais sera un homme intègre, un vrai moteur du développement, une fois placé au centre d’intérêt pour un Congo nouveau d’ailleurs en pleine construction sous l’impulsion du Président Tshisekedi.
Les idéalistes estiment que l’Esprit précède la Matière et que l’Idée précède l’Action, c’est-à-dire que l’on transforme que l’on invente et que l’on construit d’abord dans l’Esprit.
D’où l’importance des bureaux d’études, de planification et de projets avant toute exécution. Les matérialistes soutiennent, par contre, que la Matière précède l’Esprit et que l’Action précède l’Idée. Dans ce dernier contexte, le Premier ministre belge Gaston Eyskens disait que l’on agit d’abord et l’on réfléchit après. Mais, c’est lourd de conséquences parce que cela relève de l’improvisation, de la spontanéité, pourquoi pas de l’instinct. Loin de nous ce vieil débat entre le matérialiste et l’idéaliste qui nous parait infertile pour le moment. Retenons pratiquement que d’abord c’est l’Idée produite par l’Esprit, l’Action demeure la matérialisation de l’Idée.
Pourquoi et comment avoir un Nouveau Congolais capable d’aider l’Etat à édifier la Nation congolaise ou à faire de la RD Congo un véritable Etat moderne ? Le Congolais actuel a échoué à construire un Congo véritablement moderne, c’est-à-dire un Congo assis sur une Démocratie organique et réellement participative ; une Démocratie reposant sur des matériaux durables dont le respect de la Liberté, de la Justice, de l’administration et de la Croissance.
L’Etat congolais doit être le premier initiateur d’un tel projet visant à l’édification d’un tel Congolais. Il doit surveiller des travaux pour que ce Congolais ne soit pas tordu dans sa formation, car la tâche de la formation d’un homme nouveau est ardue et délicate par rapport à la construction d’un pont, d’une chaussée, d’un bâtiment, d’un avion, d’une automobile ou de tout ce qui résulte de l’intelligence humaine. L’homme est une créature de Dieu, sa transformation exige une démarche susceptible de toucher à sa conscience, à ses facultés affectives et intellectuelles par des méthodes introspective et extrospective, celles-ci doublées des sanctions pour ceux qui ne s’y prêtent pas volontairement ou qui s’y prêtent indélicatement.
Le changement de mentalité pour un Congolais Nouveau doit être la résultante de l’amélioration des conditions de vie humaines et de la formation morale, spirituelle et intellectuelle du peuple, car l’éducation ne peut produire des effets escomptés que lorsque la personne à éduquer a un ventre plein. N’est-ce pas qu’il y a une sagesse luba qui dit : kumuna mupika nkumupesha tshia kudia (Domestiquer un esclave, c’est lui assurer à manger). Ainsi une Jeunesse placée dans de bonnes conditions de vie est prête à recevoir une éducation lui proposée par son éducateur, donc son formateur.
Il y a les agents qui sont appelés à participer consciencieusement à l’éducation de la population, en général, et de la Jeunesse, en particulier. Il s’agit de la famille, l’école, l’église, l’environnement et l’Etat. Malgré cet ordre pédagogique, il revient que c’est l‘Etat congolais qui demeure un agent principal grâce à ses tâches immenses qu’il est appelé à accomplir au sein de la société. En cas d’échec dans l’éducation, l’adage suivant se vérifie : le poisson ne pourrit qu’à partir de la tête.
Voilà pourquoi l’Etat doit s’y impliquer pour que le père, l’enseignant, l’évêque et le responsable de l’environnement aient, chacun en ce qui le concerne, le courage d’assurer sa mission dans la discipline et dans le respect mutuel. Il doit en fait peser sur les parents, sur l’église, sur l’école, pour que ceux-ci sentent que tout ce qu’ils font est suivi par l’Etat lui-même. C’est ainsi que celui-ci doit créer Cadre de de concertation et tisser les mécanismes de suivi pour l’encadrement des enfants tout en assainissant les milieux environnementaux dans lesquels ils sont appelés à s’épanouir.
Le cadre de concertation de tous les agents de l’éducation doit être un lieu leur permettant d’échanger les expériences vécues dans ce domaine et aussi de discuter sur les voies et moyens de résoudre certains problèmes qui se posent de manière particulière dans certaines familles, dans certaines écoles ou dans certaines églises, où l’on enregistre parfois le cas des enfants difficiles, des élèves difficiles venant de part en part, des croyants ou des chrétiens par défaut qui désorientent les traditions et mœurs qui fondent chaque église, chaque communauté religieuse. L’amour doit être l’épicentre de toutes les discussions au sein de ce cadre éducatif.
Nous n’avons pas de réponses à toutes ces questions fondamentales, mais nous voudrions que les animateurs de ce ministère, assisté des experts en la matière, y répondent et en fassent des opuscules ou de brochures de vulgarisation de son programme selon ses différentes sections et veille à l’organisation des conférences éducatives, des séminaires de formation, etc. En ce qui concerne la Jeunesse non intellectuelle et désœuvrée, particulièrement, un programme singulier est exigé pour son encadrement efficace et résilient.
Conclusion
La République Démocratique du Congo comprend dans l’ensemble plus de 60% des Jeunes sur plus de 100 millions d’habitants disséminés à travers une superficie de plus ou moins 2.350.450 Kms carrés. Ces Jeunes ont le droit et le devoir de s’émouvoir avec minutie et esprit de défense sur l’ensemble du territoire national. Nous voulons dire qu’ils doivent revaloriser les ressources du sol et du sous-sol pour le bien-être de toute Nation congolaise.
Pour la bonne compréhension du rôle de la Jeunesse congolaise, il sied de la sectionner en Jeunesse intellectuelle et Jeunesse analphabète. Lorsque nous parlons de la Jeunesse intellectuelle, nous entendons l’ensemble des Jeunes ayant obtenu, chacun dans la vie, un diplôme d’études secondaire, supérieur ou universitaire, et qui sont à mesure d’opiner sur les causes qui freinent le développement de la RD Congo et qui seront capables de prendre conscience pour l’édification de la Nation congolaise. C’est cette Jeunesse intellectuelle que nous considérons, une fois bien encadrée par l’Etat congolais, comme le dépositaire des valeurs démocratiques et républicaines, socle d’une Nation susceptible de prendre un élan vers le développement intégral de la RD Congo. Elle est la locomotive des toutes les autres catégories de la Jeunesse.
Retenons que la Jeunesse intellectuelle est capable de s’organiser, de structurer en vue de la cohésion nationale et de la re-construction nationale. C’est ainsi qu’elle peut être catégorisée en Jeunesse intellectuelle travailleuse et la Jeunesse intellectuelle désœuvrée
(Chômeuse). La première ne poserait pas trop de problèmes quant à son apport à l’édification de la Nation congolaise si elle est bien, comme dit ci-dessus, encadrée par l’Etat ; tandis que la Jeunesse intellectuelle désœuvrée est un feu qui couve contre le développement du pays. Voilà pourquoi, elle doit être très bien encadrée pour étouffer des velléités violentes qui sont potentiellement en elle. Pour éviter cela, nous devons les recenser et prévoir une prime exceptionnelle bien budgétisée pour leur permettre de créer l’espoir en elle et de contribuer ainsi, à l’instar de la Jeunesse intellectuelle travailleuse, à la re-construction du pays.
Il existe aussi sur le terrain un nombre important de la Jeunesse non intellectuelle ou une Jeunesse dite analphabète. C’est encore elle qui constitue un danger visible que l’Etat congolais doit prévenir et chercher comment l’éradiquer, dans la mesure où cette Jeunesse permanemment droguée apparait manifestement comme un loup pour son prochain, surtout quand elle parvient à prendre le dessus sur les forces de l’ordre.
Elle est extrêmement dangereuse et nuisible surtout lorsqu’elle est manipulée à souhait et de manière malintentionnée par des prédateurs. Elle s’attaque à n’importe qui pour lui renfler quelque chose de valeur pour qu’elle puisse le revendre à vile prix et s’en servir, tant soit, parce qu’elle n’a rien à manger, à se vêtir… Elle constitue à cet effet une épine sous le pied de l’Etat congolais.
Eduquer la Jeunesse, en général, particulièrement la Jeunesse intellectuelle revient
à lui présenter un des modèles dont il peut s’inspirer de son comportement, de ses gestes, de sa lutte de libération pour l’édification de la Nation menacée de disparition par les forces négatives tant internes qu’externes. C’est ainsi que pour la RD Congo, les personnalités politiques dont Lumumba Okitasombo Patrice Emery, Tshisekedi wa Mulumba Etienne et en face de nous et avec nous Tshisekedi Tshilombo Felix-Antoine, pressenti Héros national vivant, constituent, chacun un modèle pour la Jeunesse congolaise.
Nous voudrions signaler donc que les modèles présentés sont tous politiques.
Nous savons qu’il existe aussi des modèles scientifiques et culturels. Ceux-ci seront présentés dans les études à venir.

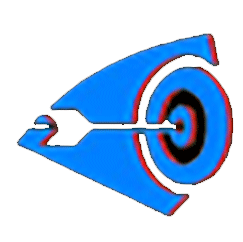
_thumbnail.jpg)










