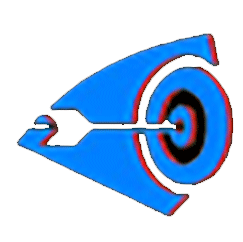La Ministre d'Etat Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale est arrivée le lundi 12 Janvier 2026 dans la région de Kigoma en République Unie de Tanzanie. Eve Bazaïba Masudi conduit une mission d'assistance humanitaire diligentée par le Gouvernement Congolais sur instruction du Président de la République. Sur place, la Ministre d'Etat Eve Bazaïba accompagnée du Vice-Ministre Tanzanien des affaires étrangères ont eu une séance de travail avec le Gouverneur de la région de kigoma et la Représentante du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés.
Dans l'ensemble, 86.918 congolais se sont réfugiés en Tanzanie à la suite de l'agression Rwandaise et l'occupation de leurs territoires par les terroristes de l’AFC/M23. Ils sont internés au site de Nyalugusu selon les chiffres officiels produits par la région de Kigoma qui à travers son gouverneur, salue la bonne conduite des réfugiés congolais.
Au nom du Gouvernement Congolais, la Ministre d'Etat Eve Bazaïba a remercié les autorités Tanzaniennes et plus particulièrement celles de la région de Kigoma pour l'accueil et l'assistance apportée aux citoyens congolais. Ceci témoigne de la bonne relation diplomatique entre les deux pays en cette période cruciale où la RDC est agressée par le Rwanda, un pays voisin.
Eve Bazaïba a rassuré de la prise de responsabilité du Gouvernement et qui ne ménagera aucun effort pour assister ses compatriotes, assurer leur prise en charge et aussi oeuvrer pour le retout de la paix." Cette mission d'assistance humanitaire à l'instar de celle menée au Burundi, constitue la volonté manifeste du Président de la République et l'ensemble du Gouvernement à trouver des solutions durables face à l'urgence humanitaire" a précisé la Ministre d'Etat qui conduit la délégation.
Dans la foulée de cette visite à Kigoma, la Ministre d'Etat Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale a échangé avec la communauté des Congolais vivant en Tanzanie, section kigoma: un message clair lancé, le Gouvernement ne pourra jamais vous abandonner et rempli ses obligations pour proteger, sécuriser son pays et son peuple.
Par ailleurs, ce mardi 13 Janvier 2026 la Ministre d'Etat Eve Bazaïba s’est rendue au camp des réfugiés de Nyalugusu pour rencontrer en signe de solidarité, les compatriotes congolais et leur apporter l'assistance nécessaire du Gouvernement.
La Pros.