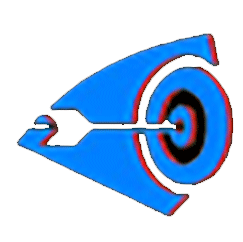Pour la 36e année consécutive, l'Afrique reçoit la première visite à l'étranger du ministre chinois des Affaires étrangères. Symbole marquant de la diplomatie sino-africaine, cette tournée annuelle du chef de la diplomatie chinoise témoigne de l'importance des liens entre les deux parties. Cette année, du 7 au 12 janvier, le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, se rend respectivement en Éthiopie, en Somalie, en Tanzanie et au Lesotho.
Lors de son séjour en Éthiopie, il va prendre part à la cérémonie de lancement officiel de l'Année sino-africaine des échanges humains et culturels au siège de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba. À l'unanimité, la Chine et l'Afrique ont décidé de faire de 2026 une année charnière dans la promotion des échanges humains et culturels. Plusieurs activités seront organisées tout au long de l'année pour mettre en avant les richesses culturelles des deux parties et renforcer la volonté commune de compréhension mutuelle. Mieux se connaître pour avancer ensemble, tel est le leitmotiv de cette année des échanges humains et culturels.
Que dire des quatre étapes du déplacement du ministre chinois des Affaires étrangères en Afrique? L'Éthiopie est un exemple concret du dynamisme de la coopération sino-africaine. Vieille de 55 ans, la coopération bilatérale entre la Chine et l'Éthiopie se distingue par des initiatives phares de développement dans divers secteurs. Elle embrasse plusieurs domaines que sont l'économie, le commerce, l'industrie, l'exploitation minière, la communication, l'intelligence artificielle et les infrastructures. Dans le secteur des infrastructures, les réalisations chinoises en Éthiopie incluent chemins de fer (la ligne ferroviaire Addis-Abeba-Djibouti), routes, zones industrielles et télécommunications avec à la clé des milliers d'emplois pour la population éthiopienne. Dans le cadre de l'Initiative « la Ceinture et la Route», l'Éthiopie est un partenaire clé de la Chine. Lorsque le Premier ministre chinois Li Qiang a rencontré son homologue éthiopien Abiy Ahmed l'an dernier à Rio de Janeiro au Brésil lors du sommet des BRICS, ils ont réaffirmé la volonté de promouvoir le développement durable du chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti, d'accroître les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux.
La Somalie, qui est la deuxième étape de la visite de Wang Yi, entretient une coopération bilatérale avec la Chine depuis le 14 décembre 1960. Depuis lors, les liens économiques et techniques se sont développés. La Chine a réalisé de nombreuses infrastructures au profit de la Somalie dans le secteur culturel (le Théâtre national de Somalie), de l'assainissement (le projet d'adduction d'eau de Hargeisa), de la santé (l'hôpital pédiatrique de Benadir), du sport (le stade de Mogadiscio) et bien d'autres. En 2024, le volume des échanges bilatéraux entre la Chine et la Somalie ont été estimés à 972 millions de dollars. Lors de son séjour en août 2025 en Chine, le Premier ministre somalien, Hamza Abdi Barre, a évoqué avec les autorités chinoises la nécessité de renforcer la coopération dans les domaines de l'agriculture, des technologies, des infrastructures et du commerce.
La Tanzanie est la troisième étape de la tournée du ministre chinois des Affaires étrangères. Les Chine et la Tanzanie entretiennent des relations bilatérales depuis le 26 avril 1964. La coopération entre les deux pays connaît un développement stable et dynamique dans des secteurs comme la santé, l'éducation, les TIC, le commerce et les infrastructures. En mai 2025, la Chine et la Tanzanie ont signé deux accords d'aide de 69,3 millions de dollars au profit du développement du secteur de la santé et d'un programme de coopération économique et technique. Dans le domaine des infrastructures, la Chine a financé la construction du chemin de fer entre la Tanzanie et la Zambie. Lors du sommet du FOCAC en 2024, les deux parties ont signé des documents dans les domaines de la connectivité et du commerce agricole.
Le Lesotho, dernière étape du périple de Wang Yi, a rétabli sa coopération bilatérale avec la Chine depuis le 12 janvier 1994. Les deux pays entretiennent une relation fructueuse dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture et du commerce. Le volume des échanges commerciaux a atteint 150 millions de dollars en 2024. La coopération dans le secteur de la santé avec le Lesotho se développe bien avec l'envoi régulier depuis 1997 d'équipes médicales chinoises dans le pays. À ce jour, 18 équipes médicales chinoises se sont succédé dans le pays d'Afrique australe. Dans le domaine du tourisme, le Lesotho est une destination bien appréciée des Chinois.
La tournée annuelle du ministre chinois des Affaires étrangères en Afrique, plus qu'une tradition, dénote de la solidité de la coopération stratégique sino-africaine. Partenaires de longue date, la Chine et l'Afrique entretiennent des relations bâties sur le respect mutuel et la prise en compte des intérêts respectifs de chaque partie. Sur les chantiers du développement, la Chine se présente comme un partenaire stratégique et fiable dans la modernisation du continent. Au cours de ses entretiens avec ses hôtes, Wang Yi pourrait évaluer la mise en œuvre des dix actions de partenariat proposées par la Chine lors du dernier sommet du FOCAC. Dans un contexte international où la paix et la stabilité sont menacées, les deux parties devront renforcer leur solidarité pour promouvoir des relations internationales plus inclusives et respectueuses du droit international. À l'occasion de sa tournée, Wang Yi, va également souligner l'impératif de promouvoir l'initiative pour la gouvernance mondiale proposée par la Chine. Ladite initiative prône le respect de la souveraineté, le respect du droit international, le multilatéralisme, l'Homme au cœur de la gouvernance et l'action dans la gouvernance mondiale.