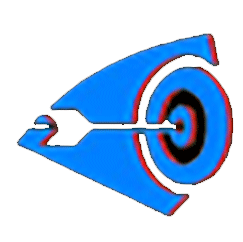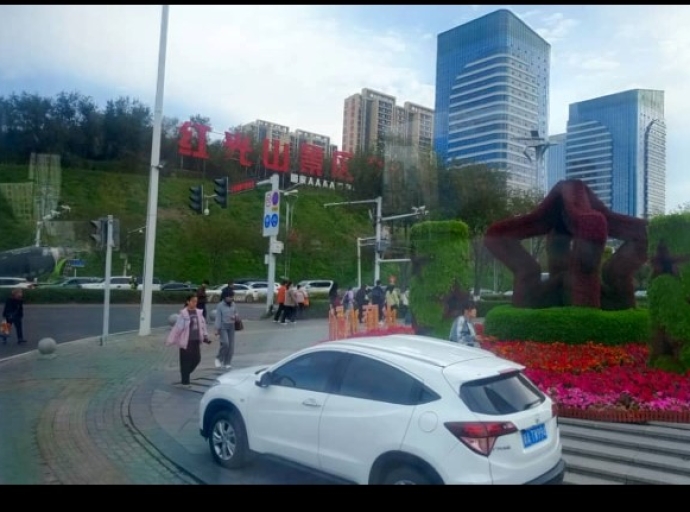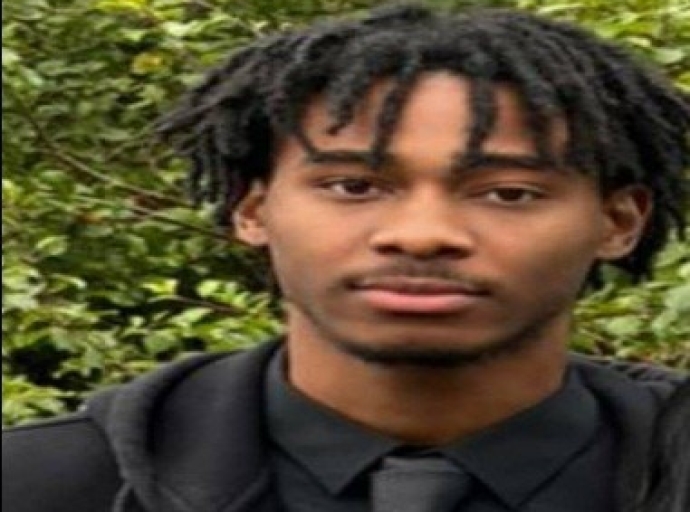Discret mais omniprésent dans plusieurs secteurs clés, le fonds Mayan Properties étend son empreinte en Afrique dans le sillage de sa maison mère, Resources Investment. Un partenariat pour plus d’un millier de clés. L’accord signé le 27 octobre entre le géant hôtelier français Accor et le fonds émirati Mayan Properties porte sur cinq projets, dont certains en Mauritanie et aux Comores. Filiale de Resources Investment qui se concentre sur des secteurs jugés clés tels que l’agriculture, les ressources minières ou la technologie, Mayan Properties est aujourd’hui actif dans dix pays, dont sept en Afrique (Maroc, Mauritanie, Tchad, Congo, Somalie, Comores et Guinée).
Spécialisé dans l’immobilier locatif, Mayan gère un portefeuille de plus de 300 millions de dollars (plus de 256 millions d’euros). Son accord avec le groupe français qui affiche 5,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024 et se positionne comme le septième acteur mondial de l’hôtellerie, vise à accélérer le déploiement des marques Novotel et Mövenpick. Bien implanté sur le continent avec 175 établissements et 15 marques, Accor espère ainsi densifier son réseau aux côtés de Mayan, à Moroni aux Comores pour Mövenpick et à Nouakchott en Mauritanie pour Novotel. Sollicités, les deux partenaires n’avaient pas donné suite au moment de la publication.
« Cet accord de développement avec Mayan Properties constitue une avancée majeure dans notre engagement à nous développer en Afrique subsaharienne. Avec la signature des hôtels Novotel Nouakchott et Mövenpick Moroni, et trois autres à venir, nous posons les fondements d’un portefeuille diversifié qui répond aux besoins réels du marché et soutient la croissance à long terme du secteur touristique africain », souligne Maya Ziade, directrice du développement de la division Premium, Midscale & Economy pour le Moyen-Orient, l’Afrique et la Turquie chez Accor.
Aux Comores, où Mayan est présent depuis 2024 et la reprise du Golden Tulip resort, le montant de la transaction n’a pas été divulgué. L’opération s’inscrit dans un programme de transformation visant à hisser le complexe au rang d’hôtel 5 étoiles sous la marque Mövenpick d’ici deux ans, avec 159 chambres à terme. Installé sur un site de 80 000 m2, entouré de verdure et bordé par l’océan, l’établissement a vocation à attirer à la fois une clientèle d’affaires et de vacanciers se rendant sur Grande Comore.
Forte présence de Mayan en Mauritanie
En Afrique, Mayan opère souvent en toute discrétion mais consacre une part notable de ses investissements à la Mauritanie. À Nouakchott, la filiale de Resources Investment prévoit la construction d’un hôtel de 170 chambres. Le Mauritania Novotel Hotel se composera de deux chalets, assortis d’une aire de jeux et d’une piscine. Parallèlement, le fonds développe un ensemble de 50 villas dotées de divers équipements – mosquée, restaurants, supermarchés –, sans préciser leur localisation exacte.
Au-delà de l’hôtellerie, Mayan étend ses activités au secteur de la santé, avec un réseau de cliniques déployées dans dix régions. Le Centre Zayed pour enfants autistes, inauguré en 2018 à Nouakchott, est également géré par la société. Financé par les Émirats arabes unis, il accueille quelque 240 enfants.
En lien avec Abou Dhabi, Mayan pilote divers projets publics, dont le port de pêche de Tanit sur la côte atlantique. Doté d’un financement de 6,5 millions de dollars, ce chantier, soutenu par le fonds d’Abou Dhabi pour le développement, vise à moderniser les infrastructures destinées aux pêcheurs artisanaux comme aux flottes industrielles. Il sera accompagné d’une usine de glace alimentaire destinée à renforcer l’industrie halieutique et la chaîne du froid.
Toujours en Mauritanie, Mayan est engagé dans la construction d’un pipeline de 180 km destiné à approvisionner en eau potable 11 000 personnes. L’eau sera prélevée dans le fleuve Sénégal et traitée dans une station située dans la région de Nouakchott. Le projet, évalué à 75 millions, est financé conjointement par l’État mauritanien et un don émirati.
Abou Dhabi, Riyad, Doha, une rivalité du Golfe en Afrique
L’alliance entre Accor et Mayan Properties s’inscrit dans la dynamique plus large d’une poussée massive des capitaux du Golfe en Afrique. Depuis une dizaine d’années, fonds souverains et investisseurs privés venus d’Abou Dhabi, Riyad et Doha multiplient leurs prises de position dans les infrastructures, l’énergie, les ports et l’hôtellerie. Une stratégie qui répond à la fois au besoin de diversification post-pétrole et à la sécurisation de secteurs jugés stratégiques, de la logistique à l’eau en passant par le tourisme.
En 2023, le fonds émirati Mubadala a investi 360 millions de dollars dans l’opérateur hôtelier suisse Aman Group, ouvrant la voie à un portefeuille de sites de luxe, dont l’Amanjena à Marrakech. Parallèlement, deux établissements estampillés Nobu sont en développement en Égypte, renforçant la présence du fonds dans l’hôtellerie premium.
Du côté qatari, la référence demeure Kasada Hospitality Fund. Créé en 2018 dans le cadre d’une joint-venture entre Accor et la Qatar Investment Authority (QIA), le fonds a levé plus de 500 millions de dollars. Il est aujourd’hui implanté dans huit pays (Afrique du Sud, Cameroun, Côte d’Ivoire, Kenya, Namibie, Nigeria, Sénégal et Rwanda) et détient une vingtaine d’actifs sous les enseignes Mövenpick, Pullman, Wojo et Ibis.