L’extraversion de certains universitaires africains

Les universitaires africains apparaissent, pour la plupart, extravertis dans leur démarche intellectuelle, versant souvent dans un mimétisme passif, que l’on pourrait qualifier de syndrome du perroquet. À la lecture de leurs travaux, l’on constate une tendance persistante à emprunter des grilles d’analyse occidentales pour les appliquer, parfois mécaniquement, aux réalités socio-culturelles africaines. Ainsi, pour expliquer des notions telles que le peuple, la nation, le droit, la liberté, la philosophie ou encore la théologie, beaucoup recourent spontanément aux catégories grecques et latines, comme si leurs propres cultures et langues étaient incapables de produire des concepts adéquats pour penser, comprendre et interpréter le réel.
Pour inverser cette dynamique, il importe de recommencer à penser le monde à partir d’un promontoire africain, selon une épistémologie enracinée dans la matrice culturelle africaine. Car connaître, dit-on, commence toujours par la connaissance de soi.
De surcroît, il est impératif pour les Africains de renoncer à l’asile mental et à l’aliénation culturelle, conditions préalables à l’émergence d’une véritable émancipation intellectuelle et épistémologique. Tant que nous continuerons de raisonner à travers les schèmes mentaux forgés par l’Occident, notre épanouissement collectif comme individuel demeurera incertain. Comme le rappelle si bien Bob Marley : « Émancipe-toi toi-même de l'esclavage mental ; personne d'autre que toi ne peut libérer ton esprit. »
À propos des langues et cultures africaines, Lilyan Kesteloot écrit avec justesse :
« C'est aux Africains à défendre leurs langues et leurs cultures en général. Nul ne voudra ni ne saura le faire à leur place. Il appartient sans doute à cette génération et aux suivantes de tenir là une promesse et un pari que les pères de la négritude échouèrent à concrétiser. »
(Histoire de la littérature négro-africaine, p. 313).
Cependant, défendre les langues africaines ne signifie pas rejeter les langues étrangères, car — comme le disait Engelbert Mveng — « chaque langue que j’apprends est une conquête, et me rend plus homme » (cité par Kesteloot, p. 319). L’ouverture linguistique n’est pas une aliénation, surtout dans un monde marqué par la mondialisation, où — selon Kesteloot — « le bilinguisme, voire le trilinguisme, doit être considéré comme un luxe, et non plus comme une aliénation » (ibid.).
Toutefois, il faut reconnaître que certaines réalités profondément enracinées dans la sensibilité d’un peuple ne peuvent être pleinement exprimées qu’à travers la langue maternelle. Kesteloot le formule clairement :
« Tout un domaine de la sensibilité de l’homme ne peut s’extérioriser que dans sa langue maternelle. C’est la part inviolable, particulière, intraduisible de toute culture. L’Africain ne peut renoncer à ses idiomes traditionnels sans ressentir une amputation grave de sa personnalité. »
(Anthologie négro-africaine, p. 11)
Dans la même perspective, Oscar Bimwenyi Kweshi rappelle que l’emprunt culturel n’est pas en soi une faiblesse, pourvu qu’il soit librement consenti et non subi. Mais il demeure nécessaire de se défaire de ce qu’on appelle la « syntaxe hexagonale », cette imitation excessive des modes d’expression français qui conduit certains universitaires africains à se percevoir plus Français que les Français eux-mêmes, au risque de s’éloigner des réalités africaines.
Enfin, Kesteloot souligne avec force que :
« La survie des langues africaines dépendra essentiellement du crédit que les Africains eux-mêmes leur accorderont. Ceci est aussi vrai pour la survie de la civilisation africaine tout entière. Sans cette survie, aucune indépendance politique ni aucun développement économique ne pourra jamais lever le préjugé qui pèse encore aujourd’hui sur le barbare, le primitif, l’évolué, le “singe des Blancs”. Ce préjugé s’amplifie lorsque l’Africain moderne adopte sans réserve les modes de vie européens, les philosophies, l’art même de l’Europe : cela prouve qu’il n’avait rien de valable à conserver, n’est-ce pas ? C’est donc aussi la justification a posteriori de l’action coloniale ! »
(Anthologie négro-africaine, p. 12).
Prof. Alain Mutela Kongo

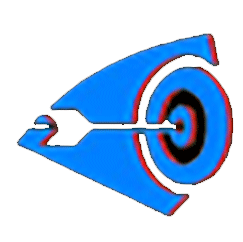



Comments est propulsé par CComment