De Washington à Doha : un processus de paix entre formalisme et pragmatisme

(Par le Professeur Christian-Junior Kabange Nkongolo)
- Introduction
La vocation de tout accord de paix est celle de signer la fin d’un conflit armé. C’est dans ce contexte qu’il convient de situer l’Accord de paix de Washington signé le 27 juin 2025 entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda. Ce nouvel épisode qui s’ajoute au nombre des multiples tentatives de pacification de l'est de la RDC, est particulièrement marqué par l'optimise des uns, notamment dû à la présence des États -Unis comme garant, et le pessimisme de ceux qui éprouvent une sensation du déjà-vu.
Néanmoins, ce qu’il y a de commun de part et d’autre, c’est que tout « vrai » congolais, quelles que soient ses appréhensions, voudrait voir la fin de la déstabilisation de la RDC et surtout, celle des souffrances imposées à tous les compatriotes qui vivent dans la partie est du pays. Ainsi donc, en réalité, les plus grands défis résident dans l'interprétation de cet Accord autant que dans la nécessité qu’il y a à garantir l’exécution de ce à quoi chacune des parties s'est engagée.
L’effectivité et l’efficacité d’un accord de paix reposent sur une double exigence, liée à une interprétation bona fides ainsi qu’à l’existence des mécanismes politico-juridiques à même d’amener les parties à assumer leurs obligations respectives. Il est donc question dans les lignes qui suivent de mettre en exergue cette double dimension, qui souligne à la fois, la pertinence des principes de droit international qui, dans une certaine mesure, conditionnent l’interprétation de l’Accord de Washington, ainsi que le pragmatisme qui caractérise la résolution des conflits en relations internationales et dont la finalité est de faciliter l’exécution de l'accord.
Toutefois, l'ambition ici n'est pas celle de vider toutes les questions autour de l'Accord de Washington. Il sera succinctement abordé la question du désengagement et du retrait immédiat et sans conditions préalables des troupes rwandaises en parallèle avec la question de la neutralisation des FDLR.
S'agit-il d'un préalable ou d'un simple concours des circonstances ? Ensuite, sous le prisme du pragmatisme, la question de la ratification sera abordée, avant de plancher in fine sur les ramifications au processus de Doha.
- Le respect des principes du droit international dans l'interprétation de l'Accord
L'interprétation d'un traité ou d'un accord de paix constitue la première étape de sa mise en œuvre dans un processus de règlement pacifique des différends. Les articles 31, 32 et 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (23 mai 1969) qui prévoient les « règles générales » de l'interprétation ainsi que ses moyens « complémentaires », combinent plusieurs méthodes d'interprétation.
Dans un premier temps, il y a le principe de la bonne foi qui impose une interprétation des mots en tenant compte de leur sens ordinaire, du contexte, de l'objet et du but poursuivis par le traité. C'est essentiellement à ce stade, qu'il convient d'entreprendre une analyse croisée entre le concept de « désengagement » et celui de « retrait immédiat et inconditionnel » en vue de déterminer leurs portées identiques ou non.
Il faut pour se faire, retenir dès l'entame, que le préambule et les annexes de l'Accord font partie intégrante du contexte (article 31 (2) de la Convention de Vienne susmentionnée). Ensuite, en parallèle au contexte, l'article 31 (3) (c) de la Convention de Vienne susmentionnée exige qu'il soit tenu compte de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
Comme on le verra, cet aspect est déterminant en rapport avec tous les aspects de l'Accord, mais plus particulièrement avec la question de la neutralisation des FDLR. Lorsque l'ambiguïté ou l'obscurité persiste ou s'il y a risque d'en arriver à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable, des moyens d'interprétation complémentaires peuvent être utilisés, notamment les travaux préparatoires, mais aussi les circonstances dans lesquelles l'accord a été signé.
a) Désengagement ou retrait immédiat et sans conditions préalables.
Ici, la question est celle de savoir si le désengagement a la même portée que le retrait immédiat et sans conditions préalables des troupes rwandaises. Pour répondre à cette préoccupation, il faut avant tout reconnaître que le désengagement, de manière générale, sous-entend soit un retrait des troupes ou simplement un repli stratégique (Voir notamment Doctrine interarmées : Désengagement (Centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentations (Novembre 2013)).
Dans l'un ou l'autre cas, le désengagement signifie que l'on quitte une posture offensive pour se replier dans une posture défensive. Or, à la suite du désengagement, l'armée rwandaise ne peut prendre une posture défensive que sur son propre territoire et non sur le territoire de la RDC, sinon alors on perpétuerait l'agression de la RDC. Ceci est d'autant plus vrai qu'en tenant compte, comme le veut l'article 31 de la Convention de Vienne susmentionnée, de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties, on ne peut donner au « désengagement » une signification ou un sens qui porte atteinte à l'obligation de respecter l'intégrité territoriale d'un Etat.
L'Accord de Washington ne peut pas être interprété en marge des principes fondamentaux du droit international, notamment la souveraineté et l'intégrité territoriale. Prenant en considération, le préambule et les annexes qui font parties intégrantes du contexte, il va sans dire que l'Accord de Washington ne peut s'interpréter qu'en accord avec les principes de la Charte des Nations unies, rappelés notamment dans l’Acte constitutif de l’Union africaine, les résolutions 2773 et 2783 du Conseil de Sécurité, l'Accord de principe signé entre les parties le 25 avril 2025 ainsi que dans le propre texte de l'Accord à son article 1er.
Ceci explique aussi pourquoi dans le CONOPS à l'annexe, c’est dès la phase 1 qui concerne uniquement les actes de préparation, que le RWANDA est déjà dans l'obligation de cesser toutes les opérations militaires transfrontalières ponctuelles. Enfin de compte, on se rend bien compte qu'il n'y a pas incompatibilité entre le retrait immédiat et sans conditions préalables et le désengagement des troupes rwandaises, sinon alors la résolution 2773 que les parties se sont engagées à mettre en œuvre (voir l’article 5 (2) de l'Accord de Washington) n'aurait pas exigé ce retrait, tout en invitant les parties à l’application du plan harmonisé de Luanda (voir les paragraphes 4 et 5 de la résolution 2773).
Dès la mise à exécution de l'Accord en conjonction avec la résolution 2773 et le CONOPS, le désengagement et le retrait des RDF feront partie des premières opérations qui doivent se réaliser avant d'envisager la suite, notamment les opérations ciblées contre les FDLR. On ne peut pas résoudre la crise pacifiquement si le Rwanda n'est pas disposé à respecter et à faire respecter les règles de droit international.
b) Neutralisation des FDLR à la lumière des principes de droit international
Dans la suite de ce qui vient d'être dit sur le désengagement, la neutralisation des FDLR doit aussi se faire conformément aux principes de droit international. Le principe de l'interdiction du recours à la menace ou à l'emploi de la force contre un autre État prévu à l'article 2 de la Charte des Nations Unies est mieux explicité dans certains instruments, notamment la résolution 2131 (XX)de l'Assemblée générale, datée du 21 décembre 1965, qui stipule entre autre que tous les États devaient s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de financer, d'encourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes dirigées contre un autre État.
En réalité, il s'agit d'une obligation réciproque qui pèse non pas simplement sur la RDC, mais aussi vice-versa sur le Rwanda et même l'Ouganda, de respecter le territoire de d’un autre État et de ne pas fournir d'appui à des activités subversives contre cet État. Or à y voir de près, c'est la RDC qui a été longtemps victime de la complicité de ses voisins et non le contraire. Depuis 1997, toutes les rebellions contre les régimes en place en RDC ont été lancées et/ou soutenues à partir de l'un ou l'autre de ces deux États (AFDL, RCD, CNDP, M23 et AFC).
En revanche, concernant les FDLR, quelques observations méritent d'être faites pour bien apprécier l’ampleur de ce qu’ils pourraient représenter en termes de menace :
➢ Absence d'attaques par les FDLR contre le Rwanda pendant plus de deux décennies :
Depuis plus de 25 ans, il n’y a PAS eu d’attaque authentifiée et vérifiée des FDLR contre le Rwanda à partir du territoire congolais. Voilà pourquoi, lors de son audition devant l’Assemblée nationale française, l’Ambassadeur Rwandais n’a pas été capable de répondre à la question de savoir à quand remontait l’attaque récente des FDLR contre le Rwanda.
Même la prétendue implication des FDLR dans l’attaque de BWINDI en 1999 n'a jamais été prouvée de manière irréfutable. Tout a toujours porté à croire qu’il s’agissait d’une mise en scène par l’armée rwandaise elle-même.
➢ Expéditions de l'armée rwandaise sur le sol de la RDC :
L’armée rwandaise s’est retrouvée sur le sol congolais à plusieurs reprises (sous l’AFDL en 1997, lors de la 2e guerre en soutien au RCD Goma, lors des opérations conjointes (UMOJA WETU 2009) et même récemment avec l'AFC/M23), sans vraiment se préoccuper de mettre la main sur les FDLR, l’objectif étant avant tout de mettre la main base sur les ressources minières du Kivu comme le souligné dans plusieurs rapports du panel d'experts des Nations Unies.
Il y a plusieurs FDLR qui sont aujourd’hui dans l’armée rwandaise et qui sont envoyés en RD Congo chaque fois qu’il faut trouver un prétexte pour justifier l'invasion du Kivu.
Le Groupe d’experts sur la RDC a réussi à percer le mystère autour de cette question lorsqu’il révèle noir sur blanc au paragraphe 30 de son rapport à mi-parcours, publié le 30 décembre 2023, que « depuis le début du mois d’octobre 2023, [...] les RDF et le M23 déployés dans les territoires de Nyiragongo, de Rutshuru et de Masisi ont été soutenus par plusieurs équipes d’appui tactique et de reconnaissance comprenant au total 250 ex-combat- tants des FDLR et opérant sous le commandement du service du renseignement de la défense du Rwanda » (voir S/2023/990).
Bien plus, des témoignages récoltés auprès des belligérants peu après la publication du rapport du Groupe d’experts, attestent que M. Bimenyimana alias Cobra, ancien FDLR rapatrié au Rwanda depuis quelques années, a dirigé un bataillon des RDF déployé aux alentours de la cite de Sake en territoire de Masisi.
➢ Disproportionnalité du rapport de force
À la vue de l’arsenal militaire de l’armée rwandaise, il est impossible et inimaginable que le résidu des FDLR puisse disposer d'un matériel et des moyens humains suffisants pour attaquer et renverser le régime de KIGALI. Le rapport de force est de loin disproportionné, entre une armée d'hommes assortie d'un matériel bien sophistiqué et une centaine d'hommes dont la plupart ont déjà pris considérablement de l'âge. De ces observations, il ressort que la question de la neutralisation des FDLR doit être nettement dissociée du soutien militaire unilatéral apporté par les RDF à la rébellion de l'AFC/M223.
Bien que l 'obligation de neutraliser les FDLR pèse sur la RDC, la question est envisagée uniquement dans une perspective et un cadre de collaboration tant au niveau du mécanisme de vérification en vigueur depuis 2012 qu'au niveau du mécanisme de coordination de sécurité prévu par l'Accord de Washington. Ceci a pour implication que toute mesure unilatérale d'envoie des troupes sur le sol congolais prise dans le passé par le RWANDA, sans accord ou consentement préalable de la RDC, ne peut en AUCUN CAS être envisagée sous le prisme de ces mécanismes.
Dans le contexte de la neutralisation des FDLR, la RDC, afin d'arracher tout prétexte fallacieux au Rwanda, a accepté de se soumettre à un régime de collaboration avec tous les partenaires régionaux et internationaux et non pas à un régime de perpétuation de l'agression. Cette démarcation vaut son pesant d'or car à l'article 1 point 4 de l'Accord de Washington, les parties s'interdisent expressis verbis tout acte d’agression et conviennent de ne pas commettre, soutenir ou tolérer des incursions militaires ou d’autres actes, directs ou indirects, qui menacent la paix et la sécurité de l’autre partie ou qui portent atteinte à la souveraineté ou à l’intégrité territoriale de l’autre partie.
La Cour Internationale de Justice, commentant la définition de l'agression annexée à la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale, a souligné que cette qualification s'applique non seulement à l'envoie des bandes armées dans un autre État, mais aussi dans l'hypothèse d'une assistance à des rebelles prenant la forme de fourniture d’armements ou d’assistance logistique ou autre (Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, Arrêt du 27 juin 1986 (CIJ Rec. 1986, pp. 14 et s.), para. 195).
Ce que l'on retient alors ici, c'est que :
− les troupes rwandaises venues en RDC unilatéralement doivent quitter le territoire congolais sans conditions, nonobstant les opérations de ciblages et de neutralisation des FDLR ;
− Les mesures défensives du Rwanda ne peuvent, sous aucun prétexte, s'exercer sur le territoire de la RDC ;
− Les représentants du Rwanda et des autres États de la région et même des autres partenaires internationaux ne peuvent se retrouver sur le territoire de la RDC en rapport avec la question des FDLR que moyennant le consentement de la RDC dans le cadre des mécanismes de vérification créé en 2012 et du mécanisme conjoint de sécurité prévu par l'Accord. Toute autre présence équivaudrait à un acte d'agression.
- La question de la ratification et le pragmatisme dans l'exécution de l'Accord de Washington
L'accord de paix de Washington est-il déjà effectif ou doit-on attendre sa ratification par le parlement congolais ? Le fait que le Rwanda ait procédé à sa ratification contraint-t-il la RDC à procéder de la sorte ? Pour répondre à cette préoccupation, il faut au préalable faire une distinction entre l'approche de droit international et celle qui relèverait strictement du droit interne.
En droit international, lorsqu'un traité doit être soumis à la ratification, il dispose généralement de la formule suivante : “les États expriment leur consentement à être liés par la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation. ” Or, l'Accord de Washington ne contient pas une telle formule.
Son article 9 stipule plutôt qu'il prend effet dès la signature, exactement comme dans les accords en forme simplifiée. On peut donc affirmer qu'il a été conclu sous une formée simplifié et que de ce fait, son application en droit international est à envisager au jour de sa signature. Mais dans le fond, s'agissant d'un accord de paix qui vise à mettre fin à un « conflit armée international », c'est légitime en droit interne, de se poser la question en rapport avec l'article 214 de notre Constitution.
Ce dernier exige que les traités de paix soient ratifiés en vertu d’une loi. A vrai dire, il n'y a rien qui puisse empêcher une telle démarche, si nécessaire. Seulement, le pragmatisme qui ressort des approches propres aux relations internationales impose parfois une autre dynamique dans la conception des accords de paix.
On peut ainsi se poser la question du pourquoi l'Accord de Lusaka du 10 juillet 199 n'avait pas non plus été ratifié alors qu'il impliquait la signature par six États africains. La question de la régularité du processus de conclusion d'un traité s'est aussi posée en rapport avec la ratification du statut de Rome par la RDC, dont le décret-loi n0013/2002 du 30 mars 2002 portant autorisation à la ratification du Statut de Rome, a été décrié par plusieurs auteurs (Prof. Balanda Minkwin, Prof. Lunda Bululu et le Prof. Kazadi Mpiana ), sans que cela ne remette en cause son effectivité de nos jours en RD Congo (Lira à ce sujet Kazadi Mpiana, J. (2012).
La Cour Pénale Internationale et la République Démocratique Du Congo : 10 Ans Après. Étude De L’impact Du Statut De Rome Dans Le Droit Interne Congolais. Revue québécoise de droit international / Quebec Journal of International Law / Revista quebequense de derecho internacional, 25(1), 57 90. https://doi.org/10.7202/1068641ar ).
Peut-être que les experts internationalistes dans les milieux universitaires pourront approfondir la question et nous éclairer là-dessus. Dans tous les cas, autant chaque État reste maître de sa procédure en interne, autant, sans préjudice des dispositions finales de l'Accord de Washington (article 8, point 2), le principe est qu'un Etat ne saurait évoquer ses dispositions internes pour refuser d'honorer ses engagements internationaux librement consentis (voir article 27 de la Convention de Vienne susmentionnée).
Le plus important pour la RDC, c'est d'aller plus vite vers la pacification de l'est et soulager les souffrances de nos populations, plutôt que de se livrer à une surdose de juridisme. Il faudra nécessairement à certaines étapes, un certain degré de pragmatisme (problem-solving) pour arriver à aller de l'avant et atteindre le but poursuivi par l'Accord de Washington, à savoir l’instauration d’une paix durable.
- Les ramifications avec le processus de Doha
Pédagogiquement, il est bon de commencer par rappeler que ce qui a été signé le 11 juillet 2025 à Doha n‘est qu’un accord de principe, c'est-à-dire un accord dans lequel les parties se mettent d'accord sur les conditions suivant lesquelles un accord futur devra être conclu entre elles. C'est une sorte d'accord préparatoire un peu comme l'accord de principe du 25 avril 2025 qui avait précédé l'Accord de paix de Washington.
Parmi les questions les plus discutées dans l’opinion publique, il y a à celle relative à la restauration de l'autorité de l'État. En réalité, cette démarche ne peut être entreprise que sous la houlette du Chef de l'État et des autres institutions prévues par la Constitution. Cette tâche ne saurait être confiée à un mouvement rebelle d'autant plus que la restauration de l'autorité de l'État sous-entend la dissolution de tous les mouvements rebelles. Il n'en saurait être autrement.
C’est sans doute à ce niveau qu’on peut principalement établir une ramification entre Doha et Washington d’autant plus que l'Accord de Washington prévoit la fin de tout soutien aux groupes armes non étatique ainsi que le désengagement, la démobilisation et l'insertion conditionnelle dans les forces de sécurité.
- Conclusion
Au demeurant, il faut considérer l’Accord de paix de Washington non pas comme un point de chute, mais plutôt comme une nouvelle étape qui s’insère dans les efforts de pacification totale de la partie est de la République démocratique du Congo. C’est sans tergiverser la raison pour laquelle on ne peut pas se hasarder à avancer une date fortuite sur le retour effectif de la paix sur terrain.
Le processus qui s’ouvre avec l’Accord Washington aura l’avantage, soit d’apporter la paix tant recherchée par les populations de l’est, soit alors d’exposer pour la nième fois la mauvaise foi de Kigali à appliquer les résolutions communes prises pour la paix.
En attendant de revenir sur les aspects économiques de l’Accord de Washington, il faut souligner que l’effectivité des processus de Washington et Doha aura pour conséquence la mise en échec de la balkanisation tant voulue par certains oiseaux de mauvais augure.

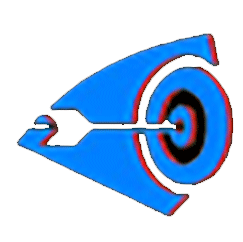



Comments est propulsé par CComment