La France et l’instabilité de la RDC : Quand l’Humanitaire devient un masque diplomatique

(Par Jean Aimé Mbiya Bondo Shabanza)
Le proverbe comme clé de lecture
Ce proverbe africain, empreint de lucidité, résonne avec une acuité particulière dans le contexte congolais actuel. Il met en lumière une vérité dérangeante : le danger ne vient pas toujours de l’ennemi déclaré, mais bien souvent de celui qui se présente comme allié. La France, sous le leadership d’Emmanuel Macron, incarne cette duplicité diplomatique. Derrière les discours de compassion et les initiatives humanitaires, Paris entretient des relations stratégiques avec des régimes régionaux dont l’implication dans les violences à l’Est de la RDC est documentée et dénoncée. Ce soutien, qu’il soit militaire, économique ou politique, contribue à prolonger une crise humanitaire que la France prétend vouloir résoudre. Il ne s’agit pas d’un simple paradoxe, mais d’une mécanique bien huilée où l’aide devient un outil de contrôle, et la souffrance du peuple congolais une variable d’ajustement dans les calculs géopolitiques.
Cette posture ambiguë transforme la solidarité internationale en théâtre diplomatique, où les gestes humanitaires servent davantage à redorer une image qu’à répondre aux urgences réelles. La main tendue de la France, censée porter secours, est la même qui, par ses alliances et ses silences complices, alimente les foyers de tension. Cette contradiction flagrante doit être dénoncée avec force : on ne peut prétendre défendre les droits humains tout en soutenant ceux qui les bafouent. La RDC n’a pas besoin de caresses diplomatiques qui dissimulent des coups portés à sa souveraineté. Elle a besoin de partenaires sincères, capables de reconnaître leur rôle dans la crise et de s’engager dans une coopération fondée sur le respect, la transparence et la justice.
Une conférence humanitaire aux allures de diversion
Le 23 septembre dernier, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, Emmanuel Macron a annoncé l’organisation d’une conférence humanitaire pour l’Est de la RDC, prévue pour octobre à Paris. Officiellement, il s’agit d’un geste de solidarité envers une région meurtrie par des décennies de conflits. Mais cette initiative soulève une question essentielle : comment prétendre secourir un peuple dont on contribue à entretenir la souffrance ?
Car la réalité est implacable : la France, tout en affichant un visage de bienveillance, soutient diplomatiquement et militairement des acteurs régionaux comme le Rwanda, directement impliqués dans l’agression et le massacre de civils congolais. Offrir du pain et des habits à un peuple que l’on contribue à tuer est une hypocrisie insoutenable.
L’hypocrisie diplomatique française
La France se présente comme un médiateur de paix, mais ses choix stratégiques révèlent une logique de domination. L’aide humanitaire devient alors un écran de fumée, destiné à masquer une politique néocoloniale qui vise à maintenir la RDC dans un état de fragilité permanente.
Cette duplicité n’est pas accidentelle. Elle s’inscrit dans une longue tradition d’ingérences où les grandes puissances, sous couvert de solidarité, cherchent à contrôler les ressources stratégiques congolaises. Derrière les discours de compassion, Paris poursuit des objectifs géopolitiques clairs : affaiblir la souveraineté congolaise, favoriser la balkanisation du pays et garantir l’accès à ses richesses naturelles.
Une tragédie instrumentalisée
Chaque jour, des villages entiers sont réduits en cendres, des familles arrachées à leurs terres et des enfants privés de leur droit fondamental à l’éducation. Ces drames, loin d’émouvoir sincèrement certaines chancelleries occidentales, deviennent des arguments de communication pour justifier des conférences et des initiatives dites « humanitaires ». Or, derrière ces gestes de façade, se cache une stratégie cynique : maintenir la République Démocratique du Congo dans une posture de victime dépendante, incapable de se relever par elle-même. La souffrance des Congolais est ainsi transformée en monnaie diplomatique, utilisée pour renforcer l’influence de puissances étrangères qui, dans le même temps, ferment les yeux sur les véritables causes de la guerre.
La France, en particulier, illustre cette hypocrisie. Comment Paris peut-il prétendre défendre la paix et la dignité humaine tout en soutenant, directement ou indirectement, des régimes et des acteurs régionaux responsables de l’instabilité ? Les massacres à l’Est de la RDC ne sont pas des accidents isolés : ils s’inscrivent dans une logique de prédation où les ressources minières congolaises attisent les convoitises. En organisant une conférence humanitaire à Paris, Emmanuel Macron cherche à se donner l’image d’un médiateur bienveillant, alors même que son gouvernement entretient des alliances qui alimentent le chaos. C’est une contradiction flagrante : on ne peut pas se présenter comme pompier quand on a soi-même contribué à allumer l’incendie.
Accepter sans conditions une telle conférence reviendrait à légitimer cette manipulation. Ce serait cautionner un système où l’aide humanitaire n’est qu’un paravent, une mise en scène destinée à masquer des intérêts géopolitiques et économiques. La RDC ne peut pas se permettre de tendre la main à celui qui, dans l’ombre, alimente le feu qu’il prétend éteindre. La véritable solidarité ne se mesure pas en promesses de dons ou en conférences médiatisées, mais en actes concrets : la fin du soutien aux agresseurs, le respect de la souveraineté congolaise et la reconnaissance du droit du peuple congolais à vivre en paix sur sa propre terre.
Tshisekedi face aux contradictions internationales
Sous l’impulsion de Félix Antoine Tshisekedi, la RDC a cessé de se contenter d’un rôle passif sur la scène internationale. Le président congolais a choisi d’affronter directement les contradictions des puissances qui, tout en se présentant comme partenaires, alimentent en réalité l’instabilité. En exposant publiquement l’hypocrisie de Paul Kagame et de son allié Emmanuel Macron, il a brisé un tabou longtemps entretenu par la diplomatie congolaise : celui de dénoncer sans détour les manœuvres étrangères qui fragilisent la souveraineté nationale. Cette posture courageuse a redonné confiance à une population longtemps habituée à voir ses dirigeants céder face aux pressions extérieures.
Ce changement de ton n’est pas anodin. Il marque une rupture avec des décennies de soumission diplomatique où la RDC, malgré ses richesses colossales, était traitée comme un simple pion dans les calculs géopolitiques des grandes puissances. Tshisekedi a replacé la souveraineté congolaise au cœur du débat, rappelant que l’intégrité territoriale n’est pas négociable et que la dignité d’un peuple ne saurait être troquée contre des promesses d’aide biaisées. En affirmant haut et fort que le Congo n’acceptera plus de compromis sur sa sécurité et son unité, il a envoyé un signal clair : le temps des compromissions est révolu.
Cette nouvelle posture diplomatique dérange, car elle met à nu l’hypocrisie des discours occidentaux. Elle révèle que derrière les appels à la paix et à l’humanitaire se cachent des intérêts économiques et stratégiques qui nient la réalité congolaise. En choisissant de dénoncer cette duplicité, Tshisekedi ne se contente pas de défendre son pays ; il incarne une voix africaine qui refuse la tutelle et revendique le droit à l’autodétermination. C’est cette fermeté qui fait de lui, aux yeux de nombreux Congolais, un homme providentiel : non pas parce qu’il promet des miracles, mais parce qu’il ose dire la vérité là où d’autres se taisaient.
Leçons de l’histoire
L’histoire congolaise des années 60 reste une leçon amère : sous couvert de paix et de développement, les ingérences étrangères ont plongé le pays dans une spirale de chaos politique, d’assassinats ciblés et de manipulations économiques. Les grandes puissances, en prétendant stabiliser le Congo nouvellement indépendant, ont en réalité orchestré des crises qui ont fragilisé ses institutions et compromis son avenir. Aujourd’hui, les mêmes méthodes se répètent avec une inquiétante régularité : conférences internationales organisées à l’étranger, aides humanitaires conditionnées à des agendas politiques, promesses creuses qui ne se traduisent jamais en solutions durables. Ces pratiques, loin de répondre aux besoins réels du peuple congolais, servent avant tout à maintenir une influence étrangère sur les affaires internes du pays.
Ce cycle d’ingérences perpétue une forme de colonialisme moderne, où l’économie et la politique congolaise restent sous tutelle déguisée. Derrière les discours de solidarité, il s’agit en réalité de contrôler les ressources stratégiques du pays et de limiter sa capacité à s’affirmer comme puissance régionale. La stabilité promise n’est qu’un mirage : chaque initiative internationale qui ignore la souveraineté congolaise ne fait qu’aggraver la dépendance et prolonger l’instabilité. Le Congo n’a pas besoin de conférences spectaculaires ni de charité conditionnée, mais d’un partenariat équitable fondé sur le respect de son intégrité territoriale et de son droit à l’autodétermination.
Pour une souveraineté assumée
La République Démocratique du Congo ne peut plus se satisfaire de cette « charité diplomatique » qui, sous couvert d’humanisme, n’est qu’un instrument de domination. L’hypocrisie de la communauté internationale, et particulièrement de la France, se révèle dans ce double langage permanent : d’un côté, des discours enflammés sur la paix, la démocratie et la solidarité ; de l’autre, un soutien tacite ou explicite à des régimes et des acteurs régionaux qui alimentent la guerre et la misère. Cette duplicité n’est pas un accident, mais une stratégie : maintenir le Congo dans une dépendance structurelle, incapable de se relever par lui-même, afin de mieux exploiter ses richesses stratégiques. Derrière chaque conférence humanitaire, chaque promesse d’aide, se cache une volonté de perpétuer un rapport de force inégal, où la souveraineté congolaise est constamment reléguée au second plan.
Face à cette réalité, l’avenir du Congo ne peut reposer que sur une rupture claire avec ces logiques néocoloniales. Il s’agit de bâtir des partenariats fondés sur le respect mutuel, et non sur la manipulation. Cela implique de renforcer les institutions nationales, de mobiliser les ressources internes et de refuser toute compromission qui fragilise l’intégrité territoriale. La RDC doit affirmer haut et fort que son destin ne se négocie pas dans les salons parisiens ou les chancelleries occidentales, mais se construit par la volonté de son peuple et la défense de sa dignité. En dénonçant l’hypocrisie de la France et de la communauté internationale, le Congo rappelle au monde que la véritable solidarité ne consiste pas à distribuer des miettes pour masquer des crimes, mais à respecter pleinement la souveraineté d’une nation et le droit inaliénable de son peuple à décider de son avenir.
Conclusion
La République Démocratique du Congo ne peut plus se laisser enfermer dans le rôle de spectatrice impuissante de son propre destin. Les mascarades diplomatiques, les conférences humanitaires organisées à grand renfort de communication et les promesses creuses ne doivent plus servir de paravent à une politique étrangère qui, en réalité, entretient la guerre et la misère. La France et ses alliés internationaux ne sauraient continuer à se présenter comme des sauveurs alors qu’ils participent, directement ou indirectement, à la perpétuation du chaos. Le peuple congolais a trop souffert pour accepter encore que sa douleur soit instrumentalisée au profit d’intérêts géopolitiques et économiques qui ne disent pas leur nom.
L’heure est venue pour la RDC d’affirmer haut et fort sa souveraineté, de refuser toute compromission et de rappeler au monde que son intégrité territoriale n’est pas négociable. La dignité d’une nation ne se mesure pas à la quantité d’aide qu’elle reçoit, mais à sa capacité à se tenir debout face aux manipulations et à exiger le respect de ses droits. En dénonçant l’hypocrisie de la France et de la communauté internationale, le Congo ne fait pas seulement entendre sa voix : il trace la voie d’une Afrique qui refuse la tutelle, qui revendique son autodétermination et qui entend écrire elle-même son avenir.

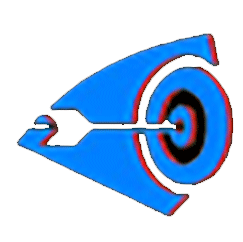



Comments est propulsé par CComment