Grands Lacs : comprendre les conflits pour reconstruire les Etats

(Par Pierre Anatole Matusila)
Dans la région tourmentée des Grands Lacs africains, les conflits s’enchevêtrent, se répètent et se transforment, au point de sembler constituer une toile de fond permanente à l’histoire contemporaine de cette zone stratégique. Entre causes endogènes – rivalités ethniques, compétition pour les ressources, fragilité des institutions – et facteurs exogènes – ingérences étrangères, enjeux géopolitiques, logiques économiques transfrontalières –, les tensions se nourrissent mutuellement. Au cœur de cette instabilité chronique, les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda cristallisent les fractures régionales. Ce face-à-face, aussi politique que symbolique, interroge la difficile construction des États dans un espace où les frontières, les mémoires et les loyautés restent en perpétuel mouvement.
Cette réflexion n’émane pas d’un politologue de formation ni d’un analyste en surplomb. Elle s’ancre dans l’expérience directe d’un acteur politique qui, depuis les Accords de Sun City, a pris part aux débats, aux négociations, parfois aux impasses. Loin des lectures abstraites ou théoriques, cette analyse s’élabore au contact du réel, dans les coulisses des rencontres diplomatiques, au cœur des tensions régionales et des espoirs de paix. Elle assume sa subjectivité – celle d’un témoin engagé – et s’inscrit dans une volonté de comprendre pour agir, de nommer les causes pour mieux les désamorcer, de penser les États non comme des données figées, mais comme des constructions toujours fragiles, à rebâtir sans relâche.
1. Les causes exogènes : entre mondialisation et pressions régionales
Dans mon expérience d’homme politique impliqué depuis les Accords de Sun City, j’ai appris à ne jamais sous-estimer le poids des forces extérieures dans les conflits qui secouent la région des Grands Lacs. Les causes exogènes ne sont pas une abstraction : elles s’invitent dans les décisions locales, s’imposent dans les rapports de force et redessinent les équilibres sans consulter les peuples concernés.
À mes yeux, ces causes extérieures se regroupent en deux grandes catégories. La première est celle des logiques globales, dominées par les enjeux de la mondialisation. Elle englobe l’avidité des multinationales pour les ressources stratégiques, les stratégies des puissances économiques, les flux financiers opaques, les intérêts géostratégiques masqués derrière les discours diplomatiques. Ici, la RDC et la région des Grands Lacs deviennent un terrain de jeu, parfois un champ de bataille, pour des forces dont les quartiers généraux se trouvent bien loin de nos réalités. La seconde catégorie est celle des pressions régionales, façonnées par la géographie, l’histoire partagée et les ambitions des États voisins. Ces dynamiques régionales pèsent lourdement sur les équilibres internes de chaque pays, et la porosité des frontières ne fait qu’amplifier les tensions. Des groupes armés circulent, s’installent, se ravitaillent ou se replient en fonction d’alliances fluctuantes. Derrière certaines rébellions, se profilent des agendas régionaux. Et dans certains cas, les États eux-mêmes deviennent acteurs directs ou indirects de l’instabilité.
1.1. Les enjeux de la mondialisation : une guerre économique sans uniforme
A propos des cause liées aux logiques globales, la vérité est que, dans le monde tel qu’il va, l’avenir appartient à celui qui produit mieux, qui vend plus et qui achète moins cher, qui réussira les meilleurs performances dans le décryptage de nos codes génétiques et dans la recherche biotechnologique etc. C’est la règle non écrite de la mondialisation libérale, une logique implacable qui transforme les États en concurrents, les territoires en marchés, et les ressources naturelles en objets de convoitise féroce. Les enjeux des grandes puissances concernent essentiellement la science, la technologie ou les industries, qui nécessitent un besoin croissant en ressources naturelles, principalement en énergie (le pétrole) et en minerais. Et dans cette logique très dynamique, la région des Grands Lacs, et singulièrement la République démocratique du Congo, occupe une place à part. Une place stratégique. Une place dangereuse tant il est vrai que les ressources minières dans beaucoup des pays du monde sont fortement entamées, si pas épuisées et présentent des coûts d’exploitation élevés et que l’Afrique détient près du tiers des réserves de matières premières de la planète. Ce continent, abandonné par des anciennes puissances coloniales qui se sont désengagées progressivement aux indépendances de ces pays se trouve au centre des nouveaux enjeux planétaires. En Afrique centrale et précisément en RDC, les gisements sont encore vierges ou mal exploités et avantageux pour les grands capitaux. Son sous-sol regorge de richesses — or, coltan, cobalt, cuivre, étain, terres rares — autant de minerais essentiels à l’économie numérique et à la transition énergétique mondiale. Sa partie Est et Sud-Est est un scandale géologique: les ressources du Katanga sont répertoriées et exploitées depuis longtemps, les Kivu et l’Ituri présentent un enjeu particulier. Leurs ressources minières demeurent encore latentes. Elles sont considérables avec des concentrations d’une teneur exceptionnelle. En Ituri par exemple, on peut obtenir l’or fin dans une proportion de 6 à 7 kg par tonne de minerai. Le Nord et le Sud Kivu possèdent des minerais rares utilisés dans l’industrie de pointe. Les spécialistes estiment que dans l’avenir les Kivu et l’ancienne Province Orientale seront le moteur économique du pays. Mais ce trésor, au lieu d’être une bénédiction, est devenu une malédiction. Dans cette partie du monde, la mondialisation, ici, ne se traduit pas par des chaînes de production équitables ou des partenariats durables. Elle prend la forme d’une guerre économique sans uniforme, menée par des multinationales, des groupes financiers et des intermédiaires opaques. Le prix à payer? Des conflits armés alimentés par le trafic de minerais, des milices qui se financent par l’exploitation illégale, et des communautés locales qui restent dans la pauvreté malgré l’abondance.
De ce fait, aux regard des enjeux de la mondialisation et de ce que la RDC regorge., notre pays est devenu non seulement la première cible et terrain de choix pour la poursuite de cette stratégie mondiale, une terre d’affrontement économique dont l’enjeu traduit une compétition implacable pour l’accès libre et exclusif aux dernières ressources naturelles non exploitées de la planète, mais également un terrain de jeu où s’opposent des intérêts qui ne visent ni la paix, ni le développement, mais la rentabilité maximale. En tout cas, placé au cœur de cette mondialisation brutale, la RDC est devenue une terre d’affrontements économiques.
Les Etats du Nord ne nous donnent aucune alternative. Ils veulent obtenir ces ressources de gré ou de force. Mais, ils ne souhaitent pas s’impliquer directement dans les conflits africains et des luttes pour le pouvoir. Ils préfèrent se cacher derrière des considérations générales et laisser agir sur l’avant-scène des opérateurs privés constitués essentiellement par des sociétés multinationales. Disposant d’énormes capitaux, ces grands industriels nourrissent désormais l’ambition de créer un nouvel ordre mondial pour protéger leur capital financier mondialisé, garantir leur expansion constante et imposer leur vision du monde. Ils se sont engagés dans une tentative de remise en cause de la souveraineté des Etats et de leur pouvoir régulateur par la création des Entités étatiques qui seraient leurs propres émanations c’est à dire des Etats vassalisés, qui fonctionneraient comme l’un de leurs organes ou des simples filiales. En un mot, ils veulent transformer les Etats en des auxiliaires précieux et efficaces pour la réalisation des intérêts privés. Ces puissances financières ont entrepris la reconquête et le remodelage des pays du monde, retraçant de nouvelles frontières comme l’ex Yougoslavie, forçant la création des nouveaux Etats comme dans les Balkans, Soudan et bientôt en Afrique Centrale. Ils procèdent par des contraintes économiques, politiques et militaires notamment par le pouvoir d’intimidation, des délocalisations ou des cessations d’investissements, l’imposition des dirigeants politiques pour protéger leurs capitaux et des déstabilisations successives par des pressions militaires ou des guerres par procuration à travers des groupes armés suscités ou appuyés et ou des Etats féodalisés. Le néo-libéralisme est une arme de conquête qui, détruit les Etats nationaux et toute autre souveraineté qui lui résisterait. Il met sous tutelle des institutions étatiques (Banques centrales, Ministères, Parlements etc.). Il s’agit d’une véritable recolonisation de l’Afrique par le capital privé international. L’ancien ordre politique africain issu de la Conférence de Berlin de 1885 est bel et bien fini. Le temps de l’ordre nouveau est venu par la seule volonté des nouveaux maîtres du monde.
Il faut avouer que tant que ces logiques ne seront pas maîtrisées, toute solution politique au conflit restera précaire. Car la paix, elle aussi, a un coût – et ceux qui profitent de la guerre ne sont jamais pressés de la financer. Ce que j’affirme ici ne relève pas d’une théorie du complot : c’est un constat de terrain, nourri par des missions, des rencontres, des rapports confidentiels. Dans les couloirs de certains forums économiques, on parle de l’Afrique et surtout de la RDC comme du futur "grenier stratégique" du monde. Mais sur le terrain, le pillage se poursuit, sous d’autres formes, avec d’autres complices.
1.2. L’Afrique des Grands Lacs et la géopolitique régionale : entre stratégies de survie et ambitions d’influence
Les Grands Lacs constituent un espace à géométrie variable qui regroupe des pays aux intérêts diversifiés dont certains ne possèdent aucun lac et ne sont pas directement concernés par les conflits des Grands Lacs. Cela pose la question préalable de l’espace à prendre en considération et de la compréhension d’un certain nombre de paramètres géographiques et historiques qui exercent une action déterminante dans la géopolitique régionale.
Comme on le sait, le concept « Grands Lacs » va au-delà de la portée géographique par rapport aux grands lacs africains (Albert, Edouard, Kivu, Tanganyika et Victoria). Les pays dits de cette Région appartiennent à plusieurs aires géographiques. Pour rappel, pour l’Afrique centrale nous avons la CEEAC, (Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale), issue de la filiation de la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale), de la CEPGL (Communauté Economique des Pays des Grands Lacs), de l’Angola, Sao Tomé et Principe. L’Afrique Orientale, trouve son expression institutionnelle dans l’EAC (Est African Community). L’Afrique australe, regroupée autour de SADC (Communauté de développement de l’Afrique Australe), exprime la volonté de RSA de jouer un rôle continental. Quant au COMESA (Marché commun de l’Afrique Orientale et Australe), il constitue un ensemble d’orientation Nord-Sud depuis l’Egypte jusqu’à la Namibie, excepté le Botswana, le Mozambique et la RSA. Toutes ces configurations institutionnelles sont le fruit de l’histoire, de la géographie, des forces politiques contemporaines et de la mondialisation qui privilégie les grands ensembles économiques.
La République Démocratique du Congo, de par sa situation géographique, se trouve au centre des plusieurs intégrations régionales et est frontalière des 9 Etats. Ces pays ont des destins liés. Le retour à la paix ne peut s’effectuer en, dehors de ces régions.
L’Afrique des Grands Lacs qui s’est imposée récemment comme entité géopolitique est le fruit des crises qui secouent de manière récurrente le Burundi et le Rwanda et dont le génocide Rwandais de 1994 fut le point d’orgue de l’horreur. Mais, c’est la situation sécuritaire en RDC qui a été l’élément déterminant en ce qu’elle constituait pour l’Organisation des Nations Unies, une menace contre la paix et la sécurité mondiale.
Cette Afrique a fini par acquérir un statut autonome. Pays enclavés, ils dépendent pour leurs échanges extérieurs des pays de l’EAC (East African Community), excepté la RDC qui a une petite façade maritime.
Cette géopolitique régionale me pousse malheureusement à dire sans détour que dans la région des Grands Lacs, la paix n’est jamais un acquis, car chaque État évolue avec une conscience aiguë de sa vulnérabilité. C’est une géopolitique de la survie, où les intérêts de sécurité nationale dictent souvent des comportements offensifs, voire intrusifs. Depuis que je suis engagé dans la vie politique congolaise, j’ai constaté à quel point la région fonctionne selon des logiques de défiance mutuelle, alimentées par l’histoire, les blessures non guéries, et les ambitions contradictoires des États voisins.
Dans ce jeu complexe, la République démocratique du Congo est à la fois cœur et cible. Cœur, parce qu’elle est au centre de la région, riche, vaste et stratégique. Cible, parce qu’elle est perçue comme faible, fragmentée, difficile à gouverner. Certains voisins la voient comme un réservoir de ressources, d’autres comme un maillon instable menaçant leur propre sécurité. D’où une série d’interventions directes ou indirectes, de soutiens ambigus à des groupes rebelles, de jeux d’alliances souvent opaques.
La géopolitique régionale n’est pas uniquement militaire. Elle est aussi économique, diplomatique, culturelle. Des réseaux transnationaux se mettent en place, parfois hors de tout contrôle étatique. Les routes commerciales informelles relient Goma à Kigali, Bukavu à Bujumbura, Bunia à Kampala. Des circuits parallèles d’exportation de minerais s’organisent, drainant la richesse congolaise vers l’extérieur sans retour équitable. Cette économie de l’ombre nourrit les tensions, affaiblit l’État congolais et renforce l’influence de certains voisins.
Mais il y a aussi une dimension historique et psychologique à cette géopolitique régionale. Le génocide rwandais, les conflits au Burundi, l’insécurité persistante en Ouganda ont laissé des cicatrices profondes. Chaque État avance avec la peur d’une contagion, d’un retour du chaos. Et cette peur justifie parfois l’ingérence. Ainsi, sous couvert de prévenir une menace, on intervient, on s’implique, on déstabilise. La souveraineté des uns devient la hantise des autres.
Je ne cherche pas ici à exonérer la RDC de ses responsabilités internes. Mais je refuse de passer sous silence le rôle actif que joue la géopolitique régionale dans l’entretien des conflits. C’est un facteur exogène puissant, structurant, qui brouille les pistes de la paix et rend les mécanismes de dialogue encore plus fragiles. Tant que chaque État de la région continuera à penser sa sécurité contre son voisin plutôt qu’avec lui, la guerre restera un horizon probable, et la paix un exercice d’équilibriste.
2. Les causes endogènes : fragilités internes et blessures jamais refermées
Si les pressions extérieures jouent un rôle indéniable dans les conflits qui ravagent les Grands Lacs, je ne saurais, en tant qu’acteur politique congolais, me contenter de désigner les autres comme seuls responsables. Il serait malhonnête – et politiquement irresponsable – de ne pas regarder en face nos propres failles, nos responsabilités internes, nos blessures historiques non soignées. Car si l’ennemi peut venir de l’extérieur, la guerre prend souvent racine chez nous.
De prime à bord, nous savons tous que les causes endogènes sont dominés par un certain nombre de facteurs négatifs, notamment la mauvaise gouvernance, l’absence de démocratie, l’accaparement du pouvoir par un individu ou un groupe ethnique, qui exerçe le pouvoir de manière autoritaire et despotique, l’exclusion érigée en système politique, le népotisme, une corruption généralisée, la violation des droits fondamentaux de la personne humaine et une misère toujours croissante.
Autrement dit, les causes endogènes des conflits dans la région sont nombreuses, imbriquées, parfois anciennes, parfois récentes. Personnellement, j’en retiens principalement trois : la crise de légitimité des institutions étatiques, les fractures identitaires et communautaires et la concurrence violente pour le contrôle des ressources et du pouvoir local. Tous ces facteurs entretiennent une instabilité politique, économique et sociale chronique et laminent impitoyablement la cohésion nationale. Chacun des Etats de la région des Grands Lacs accuse l’autre d’être le mauvais voisin faisant abstraction des contradictions internes au sein de leurs propres sociétés. Chaque pays pense que l’instabilité chez lui est le produit de la machination de son voisin et refuse de reconnaître l’existence des causes endogènes qui doivent d’abord être réglées dans le cadre national. Cependant, l’on doit savoir que ces causes ne sont pas des fatalités. Ce sont des réalités construites, aggravées par l’histoire coloniale, la mauvaise gouvernance, la manipulation politique, l’absence de justice sociale. Je les ai vues à l’œuvre dans les villages oubliés du Kivu comme dans les salons dorés des capitales africaines. Je les ai vues diviser des communautés jadis unies, alimenter la haine, justifier l’impunité. Ce sont elles qui transforment une simple tension en conflit armé. Ce sont elles qui permettent à des groupes armés de recruter, à des discours violents de prospérer, à la méfiance de devenir norme. Ce sont elles, enfin, qui rendent l’État incapable de protéger, d’unifier, d’apaiser. Je peux encore aller plus loin en épinglant deux points qui me paraissent faire partie des causes endogènes, surtout dans le cas de notre pays:
2.1. La crise de légitimité des institutions : quand l’État perd la parole et la confiance
Dans de nombreuses provinces de la RDC – comme dans d’autres pays de la région des Grands Lacs – l’État existe souvent par défaut, rarement par confiance. Il est là, il impose, il prélève, mais il ne convainc plus. C’est ce que j’appelle une crise de légitimité, et j’en ai mesuré les effets dramatiques tout au long de mon parcours politique. La légitimité est la qualité d’un pouvoir d’être conforme aux croyances des gouvernés, en ce qui concerne ses origines et sa forme. Une institution légitime est une institution à laquelle les citoyens obéissent non par peur, mais par conviction. Chez nous, cette légitimité est souvent mise en doute. À cause de manque de sincerité des élections souvent contestées, des nominations opaques, de la corruption chronique, du clientélisme, mais aussi du fossé immense entre les promesses politiques et la réalité du quotidien. L’État apparaît alors comme un corps étranger, affaibli, malgré la réalité de l’autroritarisme et de la repression, incapable d’impulser une dynamique d’ensemble et de répondre aux attentes de la population, voire complice de leur malheur.
Dans certaines régions, les habitants font davantage confiance à un chef traditionnel, à un commandant rebelle ou à une ONG étrangère qu’au représentant officiel de l’administration publique. J’ai vu des territoires entiers où le drapeau national flotte sans que l’État y exerce réellement son autorité. J’ai vu des postes de police désertés, des magistrats menacés, des enseignants impayés, des militaires oubliés. Ce vide institutionnel crée un terrain fertile pour les conflits. Car lorsque l’État ne protège plus, chacun se protège comme il peut : par la communauté, l’ethnie, la milice, les partisans ou les factions. Et lorsque l’État ne garantit plus la justice, chacun fait justice à sa manière. La violence devient une réponse, une routine, parfois même une stratégie. Mais le plus inquiétant, c’est que cette crise de légitimité ne concerne pas seulement l’État central. Elle touche aussi les institutions locales et provinciales, les mécanismes de décentralisation, les forces de sécurité elles-mêmes. Une démocratie sans confiance, c’est une démocratie en sursis. Un État sans autorité morale, c’est un État qui fragilise la paix au lieu de la garantir.
Rebâtir la légitimité ne se décrète pas. Cela exige un changement radical de gouvernance, un discours de vérité, une présence concrète sur le terrain, et surtout une capacité d’écoute. Car les peuples des Grands Lacs n’ont pas besoin d’un État fort en apparence, mais d’un État juste, transparent, et profondément enraciné dans les réalités locales.
2.2. Fractures identitaires : quand la communauté supplante la nation
Dans la région des Grands Lacs, l’identité n’est jamais une donnée anodine. Elle est un héritage, une appartenance, mais aussi une arme. Ce que j’ai constaté au fil des années, c’est que les tensions communautaires, loin d’être résiduelles, structurent encore aujourd’hui une grande partie des conflits locaux. Lorsqu’un citoyen ne se sent plus protégé par l’État, il se replie sur sa communauté, sa langue, sa mémoire. Ce réflexe est humain. Mais dans notre région, il devient explosif.
Les conflits identitaires ne surgissent pas de nulle part. Ils sont souvent réveillés, attisés, manipulés par des acteurs politiques en quête de pouvoir, ou par des entrepreneurs de violence. On active les souvenirs douloureux, on accentue les différences, on oppose les uns aux autres. Et très vite, ce qui était un simple contentieux foncier devient une guerre de clans. Ce qui était une dispute électorale prend des allures de conflit ethnique. J’ai vu des villages où des familles voisines se sont retournées les unes contre les autres, simplement parce qu’on leur avait dit que l’autre était “l’ennemi historique”. J’ai assisté à des négociations de paix où l’identité des participants comptait plus que leur projet politique. J’ai entendu, dans certains discours officiels, des phrases qui, au lieu de rassembler, creusaient davantage le fossé.
La question identitaire devient d’autant plus sensible que certaines communautés, au fil du temps, ont été exclues de la citoyenneté effective, soupçonnées d’être étrangères ou illégitimes sur certaines terres. Dans les Kivu, au Nord comme au Sud, dans l’Ituri ou encore au Tanganyika, la notion même d’appartenance nationale est mise à l’épreuve. On débat de qui est “vraiment congolais”, on nie à certains le droit de vote, d’accès à la terre, ou même à l’existence politique. Ces fractures sont des blessures ouvertes, que seule une politique courageuse d’inclusion, de vérité et de mémoire peut apaiser.
Tant que l’on continuera à penser la nation comme la somme de groupes rivaux, et non comme une communauté de destin, la guerre restera toujours une tentation. Car dans un pays divisé, il suffit d’une étincelle pour tout embraser. Je crois profondément qu’il ne peut y avoir de paix durable sans une véritable réconciliation identitaire, qui passe par l’éducation, la justice et le respect mutuel. C’est à ce prix seulement que nous pourrons passer de la coexistence à la coappartenance.
2.3. Ressources et pouvoir local : la guerre comme mode de gestion du territoire
Si l’on gratte la surface de presque tous les conflits armés dans l’Est de la RDC, on trouve, tôt ou tard, une lutte pour le contrôle d’un territoire, d’une ressource, ou d’un poste de pouvoir local. C’est une réalité que j’ai vue se répéter, presque mécaniquement, sur différents fronts. Là où l’État est absent ou délégitimé, le pouvoir devient une affaire de milice, de clan, ou d'allégeance. Et les ressources naturelles — forêts, mines, axes commerciaux, pâturages, taxes informelles — deviennent des objets de compétition féroce. Dans certains territoires, la guerre n’est pas seulement une tragédie, elle est devenue un système de gestion du quotidien. Des groupes armés, parfois issus des communautés locales elles-mêmes, imposent leur loi, prélèvent des taxes, régulent les marchés, tranchent les conflits fonciers, organisent la survie. Le fusil remplace l’institution. Et la violence devient le moyen d’accéder aux ressources et de se maintenir au pouvoir. Ce n’est pas une guerre idéologique. Ce n’est pas une guerre de religion ou de vision du monde. C’est souvent une guerre de position, de rente, de territoire. On se bat pour un site minier, pour un tronçon de route stratégique, pour une chefferie coutumière, pour une forêt convoitée. Parfois, les élections locales deviennent elles-mêmes des déclencheurs de conflit, car elles redéfinissent les accès au pouvoir — donc aux ressources.
En tant qu’acteur politique, j’ai été confronté à cette réalité : tant que l’accès aux richesses locales passe par la violence ou le clientélisme, la paix est perçue comme un danger. Elle menace les intérêts établis dans le chaos. Elle met en cause des économies parallèles, des rapports de force invisibles, des arrangements de terrain. Le retour de l’autorité légitime dérange ceux qui ont prospéré dans l’anarchie. Il ne suffit donc pas de déployer des soldats ou de signer des accords de cessez-le-feu. Il faut repenser entièrement la gouvernance locale, redonner une valeur au service public, garantir un accès équitable aux ressources, restaurer la confiance dans les mécanismes de justice et de régulation. Car là où l’État est juste et présent, la violence recule. Mais là où le pouvoir est capturé, confisqué ou contesté, la guerre s’installe et se recycle.
2.4. Dans la poudrière des Grands Lacs, la démographie avance masquée
Comme je viens d’en faire allusion dans les précédents points, on évoque souvent les conflits des Grands Lacs africains à travers les prismes du tribalisme, des luttes pour le pouvoir, des ressources minières ou des ingérences étrangères. Mais une cause plus discrète, presque silencieuse, agit avec une redoutable constance: la pression démographique. Dans cette région enclavée, à la géographie tourmentée, aux frontières poreuses et aux identités imbriquées, la démographie joue un rôle de fond que peu d’analystes osent affronter de face. Et pourtant, elle est partout: dans les sols surexploités, dans les collines surpeuplées, dans les migrations dites spontanées qui bousculent les équilibres communautaires, et même dans les discours guerriers qui prétendent défendre une terre historiquement nôtre alors qu’ils masquent des stratégies de déploiement territorial sous contrainte. Le Rwanda en est l’exemple le plus frappant: pays de mille collines, mais aussi de mille hommes au kilomètre carré, il est l’un des États les plus densément peuplés du continent. Une démographie galopante, une terre rare, des politiques d’aménagement limitées par le relief, et une jeunesse en quête d’espace, de travail et de perspectives. Le cocktail est explosif. Et lorsque cette pression interne devient ingérable, elle déborde sur les voisins, notamment la République démocratique du Congo, immense territoire mal contrôlé, à la population moins dense mais tout aussi précaire. L'Est du Congo, avec ses forêts, ses montagnes, ses champs et ses villes-frontières, devient le réceptacle involontaire de cette surcharge humaine, un exutoire géographique pour une densité invivable. Mais ce déplacement de population n’est pas qu’un fait démographique: il devient politique, stratégique, conflictuel.
Les communautés locales perçoivent ces mouvements comme des tentatives d’appropriation, d’invasion silencieuse, surtout quand ils s’accompagnent d’une militarisation progressive du territoire. Ainsi, les migrations liées à la pression démographique alimentent des tensions foncières, qui dégénèrent en violences, puis en discours identitaires, et enfin en guerres. Dans certains cas, ces mouvements sont encouragés, voire orchestrés, par des gouvernements ou des élites militaires pour consolider une présence communautaire dans une zone convoitée. C’est ce qu’on a vu avec les rébellions à l’Est de la RDC, portées par des populations historiquement minoritaires mais soutenues politiquement et militairement depuis l’étranger. Derrière les revendications d’appartenance citoyenne ou les demandes de sécurité, il y a aussi une réalité démographique brute: il n’y a plus assez de place là-bas, alors on pousse ici. Cette dynamique transforme la géographie en géopolitique, les collines en lignes de front, les courbes de croissance en déclencheurs de crise. L’urgence est là: comprendre que la démographie n’est pas un arrière-plan technique, mais un moteur central des conflits dans la région. Elle est la variable que personne ne maîtrise et que peu osent nommer, car elle met en cause des choix nationaux, des équilibres fragiles, des pactes coloniaux oubliés. Elle oblige à repenser les frontières, les modèles de développement, les rapports à la terre. Ignorer cette bombe silencieuse, c’est continuer à traiter les symptômes en fermant les yeux sur la maladie. Dans les Grands Lacs, les armes parlent souvent plus fort que les chiffres. Mais ce sont parfois les chiffres, surtout ceux de la croissance démographique, qui expliquent pourquoi les armes ne se taisent jamais.
3. Conflits RDC-Rwanda : l’ombre persistante des Interahamwe
Parmi les foyers les plus persistants de tension dans la région des Grands Lacs, le conflit récurrent entre la République démocratique du Congo et le Rwanda demeure un point de cristallisation. Il ne s'agit pas seulement d'un contentieux bilatéral entre deux États voisins: ce face-à-face mêle histoire, mémoires blessées, intérêts économiques et sécurité régionale. Depuis plus de deux décennies, cette relation instable est alimentée par une méfiance profonde et des accusations réciproques — d’un côté, celles d’ingérence militaire et de pillage des ressources; de l’autre, la dénonciation de la présence de groupes armés hostiles sur le sol congolais. C’est dans ce contexte tendu que, en 2005, en tant que membre du Comité Préparatoire National de la CIPGL(Conférence Internationale sur la Paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la Région des Grands Lacs), après la signature de la Déclaration de Dar-es-Salam par les Chefs d’Etats des pays membres de la CIPGL pour faire l’état des lieux sur l’évolution du contexte dans les provinces frontalières du Rwanda (La Province Orientale, le Nord Kivu et le Sud Kivu), j’ai pris part à une enquête de terrain cruciale menée au niveau en vue de mieux comprendre l’enracinement des groupes armés rwandais, en particulier les Interahamwe, devenus les FDLR (Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda), et à formuler des propositions concrètes pour leur désarmement, démobilisation et rapatriement. Ce travail a révélé la complexité du problème.
3.1. Brève historique des conflits.
Ainsi que tout le monde le sait, les conflits entre la RDC et le Rwanda remontent au génocide Rwandais de 1994 dont les Interhamwe (personnes qui s’entendent fort bien en kinyarwanda) seraient les détonateurs. Les Interhamwe/FDLR comprennent au départ, la milice HUTU qui s’est constituée à travers tout le Rwanda, suite à l’échec du processus de démocratisation de ce pays, initié par les Accords d’Arusha, alors que le FPR (Front Patriotique du Rwanda) menaçait, à partir du Nord, de prendre le pouvoir à Kigali. La destruction, le 6 avril 1994, de l’avion du Président Habyarimana en phase d’atterrissage à Kigali, par deux missiles, a engendré des dérives qui ont abouti au génocide des Tutsi et aux massacres des Hutu modérés. Tout un pays a traversé la frontière pour se réfugier dans des camps en RDC. Des hommes en armes (Interhamwe et des soldats HUTU des ex FAR) qui n’étaient pas séparés des civils s’emparent du pouvoir dans ces camps pour contrer le retour des réfugiés. C’est la crainte de les voir se réorganiser pour tenter de reconquérir le pouvoir qui est à l’origine de la grande offensive lancée par les nouveaux maîtres de Kigali en 1997 qui a engendré l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL).
Les miliciens HUTU se sont dispersés dans la forêt profonde de notre pays, à partir duquel ils ont entrepris plusieurs tentatives infructueuses pour la reconquête du pouvoir à Kigali. Les Interhamwes furent les alliés des Patriotes résistants Maï-Maï et des FAZ (Forces armées Zaïroises) pour combattre l’occupation Rwandaise de notre pays et les troupes de RCD (Rassemblement Congolais pour la démocratie).
Plusieurs compromis juridiques en apparence contraignants (Accord de Lusaka, Accord de Pretoria, etc.) liant notre pays et le Rwanda, notamment en ce qui concerne le désarmement et le rapatriement de ces forces négatives et génocidaires, n’ont pas été entièrement concrétisés.
La présence des Interhamwe sur le sol congolais est le motif souvent évoqué par le Rwanda pour justifier les agressions répétitives de notre pays. L’obsession sécuritaire du Rwanda, vidée pourtant par plusieurs accords ne peut en aucun cas justifier l’occupation de notre pays par ses troupes. Ces agressions incessantes dissimulent d’autres enjeux dont les Interhamwe ne seraient qu’un prétexte.
3.2. La problématique des Interhamwe/Fdlr
Outre qu’ils empoisonnent les relations entre le Rwanda et la RDC, les Interhamwe ne constituent plus potentiellement une menace stratégique pour le Rwanda, au contraire ils apportent plus des problèmes à la RDC. Les Interhamwe gèrent d’énormes étendues du territoire congolais. Ils prélèvent taxes, impôts, distribuent la justice et sont très actifs dans le commerce et l’exploitation illicite des matières précieuses de la RDC. Cet activisme leur permet de disposer des ressources suffisantes pour assiéger la RDC. Ils disposent des ramifications dans les pays voisins. Leur survie prolongée tient également d’un appui politique et logistique sans conteste.
Les populations congolaises vivant dans les zones où opèrent les Interhamwe sont victimes des barbaries multiples et indescriptibles parmi lesquelles le déplacement des populations avec toutes les conséquences sur le plan humanitaire, social et économique, les actes de vandalisme: destructions ou incendie des maisons, des écoles, des centres de santé etc., le vol et pillages (argents, biens matériels, produit de l’élevage notamment poules, cobayes, lapins, moutons, chèvres, porcs, vaches, et produits agricoles), l’enlèvement des personnes et des familles avec parfois demande de rançons, suivi oui ou non d’exécutions sommaires en cas de non-paiement, tortures, meurtres, ainsi que les viol et esclavagisme sexuel avec comme conséquence grossesses non désirées, transmission des VIH/SIDA et autres MST. Sur le plan social cela pose le problème de dislocation des familles et d’intégration des enfants issus de ces viols.
3.3. Effectif des Interhamwe opérant en Rdc
On a trop souvent expliqué les tensions entre la RDC et le Rwanda par la seule présence des Interahamwe/FDLR, comme si cette ombre commode suffisait à justifier toutes les incursions et à masquer les véritables enjeux ; mais posons la question frontalement : combien sont-ils réellement encore présents sur notre territoire, vingt ans après le génocide ? En effet, jusqu’en 2005, année de l’enquête, la MONUC avait rapatrié 12.000 personnes dont le tiers composé des combattants. Ces éléments comprennent des Interhamwe, des ex-Far, des militaires Burundais et Ougandais. C’est le noyau dur qui était resté en RDC.
Il existe une controverse sur l’effectif réel des Interhamwe/Fdlr et ex-Far opérant actuellement en RDC : 10.000 personnes pour les uns dont 6.000 issues de la première génération et le reste étant constitué des enfants formés sur place. Pour les autres, leur nombre ne dépasserait pas le tiers de ce chiffre qui représente un fourretout : des réfugiés pris en otage par un petit groupe et placés devant un choix difficile entre se faire tuer pour traîtrise ou combattre pour leur survie, des réfugiés hutu cultivateurs, traqués par les RCD, et dotés d’armes pour leur survie et qui vivent en bonne intelligence avec la population locale (Ils ont introduit la culture de pomme de terre, tomate et oignon), des enfants arrivés en bas âges, ceux qui sont nés au Congo et qui sont devenus des enfants soldats, toutes les filles et femmes qui les accompagnent. Toutes ces catégories ne doivent pas être confondues aux génocidaires n’en déplaisent aux tenants de cette assertion. Beaucoup d’observateurs pensent qu’actuellement, 30 ans après le génocide, leur nombre ne dépasserait pas 2.000 combattants et serait composé en majorité par des Interhamwe de deuxième génération.
3.4. Stratégies pour le désarmement et le rapatriement des Interhamwes
La présence résiduelle des Interahamwe, devenus FDLR, dans l’est de la RDC continue d’être instrumentalisée comme prétexte à l’instabilité, aux interventions armées et aux tensions diplomatiques. Pourtant, au fil des années, leur nombre réel a diminué, leur organisation s’est fragmentée, et leur menace directe s’est relativisée. Dès lors, la véritable question n’est plus tant celle de leur existence que celle des stratégies crédibles et concertées pour en finir avec cette épine diplomatique. Elle est, à mon humble avis, celle-ci: faut-il les attaquer militairement ou procéder au désarmement volontaire ? Si la réponse est affirmative, alors, le choix des options à lever doit inciter à la prudence compte tenu des conséquences qui pourront en découler.
Les FARDC sont partisans de l’option militaire. Ce choix a montré une limite opérationnelle liée notamment à l’absence d’un soutien logistique pour le transport des troupes et d’un salaire motivant. En plus, l’armée était confrontée à une autre difficulté de taille : comment préserver la vie des congolais utilisés comme boucliers humains par les Interhamwe?
Les Patriotes résistants Maï-Maï (WAZALENDO) les ont côtoyés dans la forêt du Sud-Kivu pendant 7 ans et ont réalisé des opérations militaires communes dans la lutte contre l’occupant Rwandais et les troupes de RCD. Autant dire qu’ils les connaissent très bien ; leurs zones de retranchement, leurs systèmes de combat etc. Leurs rapports se sont détériorés après la signature de l’Accord de Lusaka. Les Interahamwe craignaient d’être sacrifiés par leurs anciens alliés dont nombreux ont quitté la forêt pour intégrer les Forces armées congolaises en entraînant quelques interahamwe qui ont regagné le Rwanda notamment ceux qui étaient confrontés aux multiples difficultés dans la forêt ou persuadés de l’impossibilité de conquérir le pouvoir par les armes. Ces efforts furent annihilés par la diaspora Hutu.
Face à l’aggravation des atrocités, 80% des personnes interrogées lors d’une enquête réalisée par ACADHS, une association des droits de l’homme du Sud-Kivu, ont optée pour l’usage de la force pour les rapatrier. Le leadership des autorités des FDLR pour convaincre les combattants avait montré des limites.
Plusieurs tentatives pour aboutir au rapatriement volontaire des Interhamwe vers le Rwanda afin de sécuriser les élections de 2006 n’ont pas abouti notamment des pourparlers entre le Gouvernement de Transition et les FDLR sous les auspices de la Communauté San Eugidio, la volonté de l’Union Africaine manifestée par la mise sur pied d’une force panafricaine pour suppléer une armée congolaise sans logistique, mais annihilée par manque des ressources financières et des pays contributeurs des troupes.
Le Conseil de sécurité avait renforcé, par une résolution, le mandat de la MONUC dont l’effectif était porté à 17.000 unités, pour assurer le rapatriement volontaire des groupes armés étrangers basés en RDC, tout en enjoignant les FARDC à assumer leurs responsabilités en cas d’échec de cette opération.
3.5. Le Rwanda souhaite-t-il le retour des Interhamwe?
On peut évoquer toutes les stratégies possible pour le désarmement et le rapatriement des Interahamwe, mais la question demeure : le Rwanda souhaite-t-il le retour des Interhamwe?ces groupes armés ?
Pour mieux répondre à cette question, il est essentiel de noter qu’il n’y pas d’actions incitatives dans ce sens. La première vague de rapatriement volontaire exécutée par la MONUC en 2005, avait été dénoncée par le Gouvernement Rwandais, au motif que les Interahamwe pourraient se venger sur la population et liquider certains témoins du génocide. L’armée Rwandaise a traversé plusieurs fois notre frontière pour contraindre les Interhamwe à pénétrer en profondeur dans le Kivu, loin dans la forêt afin de créer leur propre espace vital. Autant dire que le Rwanda s’oppose au retour des Interahamwe. Le Chef de l’Etat Rwandais, ne cessait d’affirmer sa volonté, plusieurs fois renouvelées dans ses déclarations, d’occuper l’espace congolais quand il voudra et comme il voudra, pour traquer les Interahamwe ; l’Est du pays étant considéré par ce pays comme un ventre mou.
Les Interhamwe s’opposent à leur rapatriement forcé. Ils réclament un dialogue Inter rwandais et sollicite l’aide des Congolais pour exercer des pressions sur le Rwanda. Pour Kigali, le dialogue inter-rwandais a déjà eu lieu en 1993 à Arusha en Tanzanie. Cela a abouti au génocide des Tutsi. Il y a eu par après une Transition qui a été sanctionnée par des élections à tous les niveaux.
La stratégie rwandaise est guidée par des prétentions sécuritaires avec des arrière-pensées politiques, économiques et militaires évidentes pour contrôler la RDC à travers des hommes de paille, à défaut d’annexer une portion du territoire de ce grand pays qu’il considère comme une glaise molle, pour agrandir son espace vital.
Le panel des experts des Nations Unies sur le pillage des ressources naturelles de la RDC a mis en exergue le rôle majeur joué par certains ressortissants de ce pays dans ce processus très lucratif. Le Rwanda a du mal à se priver facilement de ce trésor de guerre qui constitue un appui budgétaire non moins important. Ce pays affiche souvent des taux de croissance au-delà de 6%. Ce résultat est artificiel car environ la moitié du Budget du Rwanda provient des dons et de la fiscalité interne et l’autre moitié du pillage des ressources minières du KIVU et de l’ITURI. Que ces dons cessent et que l’armée rwandaise et ses supplétifs locaux soient chassés du KIVU, ce pays enclavé et surpeuplé connaîtra des problèmes politiques, ethniques et économiques dramatiques. La guerre exige des moyens financiers, humains et matériels importants dont ne dispose malheureusement pas « le pays des mille collines ».
L’environnement sécuritaire de la Région des Grands Lacs est bien connu. Pourtant la RDC a préféré ignorer délibérément les positions belliqueuses du Rwanda si régulièrement répétées. Elle a choisi d’être unilatéralement de bonne foi. Les accords régionaux et bilatéraux qui lient nos deux pays ne dispensent pas la RDC de disposer d’une armée dissuasive, redoutable, pour garantir l’intégrité territoriale, l’intangibilité des frontières, la liberté des citoyens et la protection de leurs biens. Le devoir de défense qui incombe au Gouvernement de la République est un impératif absolu. Comment ce devoir est-il assumé ? Il revient à notre peuple de mesurer ce qu’il en coûte d’être nonchalant et d’avoir à faire à un Etat mal organisé, mal structuré, sans vision d’avenir et qui se laisse torpiller aussi facilement par toutes les vagues étrangères.
4. La construction des Etats et l’intégration régionale
On parle volontiers, dans les forums diplomatiques et les sommets régionaux, d’intégration économique, de libre circulation, de coopération sécuritaire ou de marché commun. Mais une vérité dérangeante demeure, que l’on contourne souvent par diplomatie ou par habitude : Il n’y aura pas d’intégration régionale véritable sans construction des Etats. Les Etats doivent être en mesure d’assumer pleinement leurs prérogatives et contrôler effectivement leurs territoires respectifs. La région des Grands Lacs constitue une entité interactive.
Tant que les fondations internes des pays restent fragiles, tant que les institutions chancellent, tant que l’autorité publique se délite, toute tentative d’unir les États sera une façade fragile, traversée de méfiances, de replis et de trahisons. Cette conviction, je l’ai forgée au fil de mon engagement politique et des négociations régionales auxquelles j’ai pris part. Elle repose sur un constat clair : on ne peut bâtir une région solide avec des États qui vacillent. Et si les États vacillent, c’est bien souvent parce que la Nation n’a pas été pleinement construite et que l’ethnie reste, trop souvent, le seul refuge identitaire. Avant de rêver d’un destin commun régional, il nous faut poser les vraies questions : avons-nous réussi à faire Nation ? L’État congolais – comme d’autres dans la région – parle-t-il à tous ses enfants ? Ou bien l’ethnie, la tribu continue-t-elle d’être la boussole politique, la matrice du pouvoir, le refuge dans la peur ? Que n’est-il de l’Etat? C’est à partir de ces de ces interrogations/réponses que je voudrais conclure cette réflexion.
4.1. La construction de la Nation, ciment de la cohésion nationale
La construction de l’Etat est un processus historique, laborieux et de longue haleine. Dans beaucoup des pays développés, la nation précède l’Etat. Les citoyens de ces pays ont réalisé un consensus relativement solide sur certaines valeurs fondamentales et fondatrices, concrétisant ainsi leur volonté de vivre ensemble ou, sur des questions majeures qui ne sont pas remises en cause et qui expriment la solidité du système tout en acceptant la possibilité d’une dissension sur les restes : institutions administratives et politiques, choix des actions, échelles des priorités etc., ce domaine est laissé à un jeu entre les forces politiques et sociales, les règles du jeu étant plus ou moins acceptées par tous.
En revanche en Afrique et suite à la colonisation, l’Etat précède la nation ou plutôt l’Etat a été créé sans base nationale. En traçant à la hache ou à la règle les frontières linéaires artificielles et arbitraires, la colonisation a séparé les peuples qui étaient unis et a contraint des peuples que tout sépare, de vivre ensemble. En Afrique une fraction de l’ethnie ou de la tribu est souvent détachée du tronc principal situé de l’autre côté de la frontière. Ces cloisonnements apparaissent comme des véritables « prisons des peuples ». Tant que ces peuples furent soumis à un seul maître étranger, ces entités administratives arbitraires et artificielles posèrent moins des problèmes. Les difficultés apparurent aux indépendances.
Contraint de cohabiter sous la colonie, nombreux de ces Etats, ont choisi de vivre ensemble après leurs indépendances. L’objectif majeur serait de construire la nation autour de vouloir vivre ensemble, c'est-à-dire, opérer une convergence ponctuelle sur des questions majeures qui déchirent la Nation (l’ethnisme ou le tribalisme, l’ordre social et politique etc.), avec possibilité de dissension sur les autres. Il fallait discuter des règles de jeu devant régir le « vouloir vivre ensemble », autour d’un idéal commun comme le suggère aujourd’hui le Pacte social pour le bien vivre en semble initié par la CENCO et l’ECC et comme l’a suggéré hier l’ABAKO, à la table ronde politique de Bruxelles en 1960 pour se doter d’un Etat assis sur des bases solides afin de cimenter l’ordre identitaire à l’ordre juridique.
Les Etats postcoloniaux ont préféré brûler les étapes par un raccourci autoritaire en choisissant d’être « uni par le sort et par l’effort pour l’indépendance » et plus tard en imposant les Partis-Etats issus des coups d’Etat militaires, comme en RDC. Le parti unique s’identifiait à l’Etat. L’ethnie était combattue car à leurs yeux, elle détenait un potentiel de division et d’affaiblissement de l’Etat. L’ethnie fut niée au nom du refus des différences et de l’idéologie universaliste de «village-terre». En même temps, le pouvoir était détenu par une oligarchie à base ethnique, voire même clanique, s’identifiant au parti unique, donc à l’État. La contradiction était totale.
4.2. L’ethnie, la tribu et l’Etat
Les sociétés des pays de l’hémisphère Nord sont individualistes. Les sociétés traditionnelles africaines par contre sont communautaires, solidaires et hiérarchisées. L’individu n’existe que par rapport à sa communauté. Son destin est lié à celui de son groupe (ethnie, tribu, clan) auquel il reste soumis sans contrainte particulière, mais par attitude culturelle. L’ethnie ou la tribu sont des collectivités présentant certains caractères distinctifs communs de langue, de culture ou de civilisation. Ce sont des réalités socioculturelles, des données sociologiques objectives et spécifiques. Les ethnies constituent partout en Afrique le soubassement de la vie politique et l’élément le plus important dans les conflits internes. Trop souvent les élections en Afrique se transforment en simples recensements ethniques.
Le déficit démocratique, la mauvaise gouvernance, l’échec des politiques d’intégration, le sentiment d’exclusion ou d’anéantissement par un pouvoir d’obédience ethnique etc., ravivent la conscience ethnique ou tribale et assure la fonction idéologique de rassemblement et de mobilisation par lequel l’ethnie ou la tribu s’introduit dans la sphère politique. Il se produit un divorce entre la nation « charnelle » qu’est l’ethnie et l’État. Dans ces conditions comment prétendre construire l’Etat quand les réalités sociopolitiques composant les pays (ethnie, tribu) sont niées jusqu’à l’absurde? Les solutions passent par le parler vrai qui impose de regarder les faits en face, non de les éviter ou de les escamoter. Les constructions étatiques fondées sur les modèles inspirés des colonisateurs sont en décalage par rapport aux réalités africaines. Ils ne permettaient pas aux différents groupes ethniques de cohabiter dans une harmonie sociale intégrant les notions contradictoires de « communauté de destin » et de « respect de différences »
4.3. Le diktat démocratique
A la Conférence franco-africaine de La Baule, organisée en 1990 après la chute du mur de Berlin, la question du pouvoir fut alors posée car les échecs de trente années des indépendances apparurent alors au grand jour et plus personne n’avait intérêt à les masquer. Toutes les voies de développement imposées à l’Afrique ont échoué. En ciblant les symptômes et non les véritables causes de l’échec du développement, les thérapeutiques proposées se sont révélées inefficaces.
La maladie a été vite identifiée et le traitement de choc prescrit aussitôt : l’échec fut attribué au déficit démocratique et l’Afrique subit ensuite un véritable « diktat démocratique ». De la dictature militaire, l’Afrique a basculé vers la dictature de la démocratie, sous l’imposition des « gardiens du dogme démocratique ». L’affirmation à la liberté et à la démocratie des peuples du monde crée par le vent de la Perestroïka qui a soufflé sur le monde après la chute du mur de Berlin a engendré en Afrique l’émergence des Conférences Nationales Souveraines, véritables institutions révolutionnaires traduisant l’expression d’un désir de subversion de l’ordre politique et juridique établi. Ce placage démocratique entraîna certes la fin des régimes des partis uniques ou du moins leurs redéfinitions, mais a eu pour conséquence le triomphe de l’’ethno mathématique électorale. Le pouvoir revenait automatiquement aux ethnies les plus nombreuses. Donc on a imposé aux sociétés communautaires, un système individualiste (un homme, une voix) propres aux sociétés occidentales. Cela engendra une multiplication des crises et apparut comme une catastrophe. Comment éviter que les ethnies les plus nombreuses soient définitivement propriétaires du pouvoir ? Comment réaliser de mode de représentation et d’association au pouvoir des peuples minoritaires, condamnés par la mathématique électorale démocratique, à être pour l’éternité écartés du pouvoir et de ses avantages ? Ces derniers n’ont alors le choix qu’entre la soumission ou la révolte comme ce fut le cas au Rwanda, où la perspective de l’ethno-mathématique électorale entre a engendré le génocide qui est la cause principale de l’instabilité chronique dans la Région des Grands Lacs.
5. Conclusion générale : au cœur des crises, des racines profondes
Au terme de cette réflexion, une conviction s’impose : les principales crises dans la Région des Grands Lacs sont structurelles et qu’elles ont une origine historique, politique et culturelle. Elles ne relèvent ni de la fatalité géographique ni d’une simple succession d’incidents politiques. Elles plongent leurs racines dans des dynamiques historiques, politiques et culturelles complexes, enracinées dans le passé colonial, consolidées par des indépendances mal maîtrisées, exacerbées par la faiblesse des institutions, et prolongées par une mémoire collective encore douloureuse. Si, pour des raisons personnelles, je n’ai pas abordé en détail ces dimensions historiques et culturelles dans ce texte, elles n’en sont pas moins fondamentales. On ne comprend pas les conflits d’aujourd’hui sans interroger les héritages d’hier : les frontières tracées sans les peuples, les ethnies administrées comme des entités fixes, les États construits sans Nations, les violences politiques transmises de génération en génération. L’histoire coloniale, la gestion du pouvoir post-indépendance, les traumatismes collectifs laissés sans réparation ni vérité, pèsent lourdement sur le présent.
C’est pourquoi la recherche de solutions ne peut se limiter à des dispositifs sécuritaires, à des accords politiques ponctuels ou à des injonctions extérieures. Elle doit intégrer ces paramètres profonds: comprendre les mémoires blessées, reconstruire des institutions légitimes, désarmer les discours identitaires, restaurer la confiance des citoyens envers l’État. Elle doit aussi impliquer une pédagogie de la Nation, une éducation à l’unité, un récit collectif qui rassemble plutôt qu’il ne divise. Les crises de la région des Grands Lacs appellent des réponses lucides, enracinées dans la connaissance du passé et tournées vers un avenir à reconstruire, patiemment, avec courage et responsabilité. Le Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble initié par la CENCO et l’ECC pourra, nous l’espérons, suppléer aux faiblesses de la CIPGL.
La recherche des solutions pour juguler ces crises nous amènent finalement à dire que, dans le modèle de développement imposé par les grandes puissances, l’Afrique n’a pas été préparé pour devenir actrice de son destin. Malgré nos indépendances, les anciennes puissances coloniales et les sociétés privées qu’elles traînent dans leur sillage, ne sont pas décidées à nous laisser les coudées franches. Les puissants d’hier sont les mêmes aujourd’hui et mettent tout en œuvre pour rester les puissants de demain. Celui qui contrôle les finances d’une nation n’a pas besoin du contrôle total sur la gestion politique intérieure pour être le vrai patron. Si la RDC ne s’éveille, elle finira par mourir ; de mort douce ou violente marquée par une recolonisation plus radicale, parce que mieux pensée que celle du 19è siècle et qui ne nous laissera aucun espace d’expression. Nous avons des craintes, pour paraphraser Collecte Braeckman, « de voir l’Est du pays mis en coupes réglées par des intérêts étrangers au risque de subir le sort des indiens du Far West éliminés à cause de l’Or ou des Ogonis du Nigeria sacrifiés au pétrole ».
La stratégie Rwandaise, guidée par des prétentions sécuritaires, procède d’un calcul rationnel pour piller les ressources de notre pays au bénéfice des intérêts étrangers et avec des arrières pensés expansionnistes pour agrandir son territoire. En tout état de cause, la RDC doit se débarrasser sans délai des bandes armées encombrantes qu’il avait été contraint d’offrir une hospitalité qui devient extrêmement couteuse et humiliante pour notre pays et pour notre peuple.
Les Africains doivent prendre une autonomie intellectuelle en cessant de servir de champs d’expérimentation pour les idéologies les plus désincarnées, sorties des cerveaux des autres sans impact réel sur nos problèmes. Les constructions étatiques fondées sur les modèles inspirés des colonisateurs sont en décalage par rapport aux réalités africaines et ont montré leurs limites. L’absence d’une pensée libérée est la cause principale de notre dérive collective.
Kinshasa le 28 juillet 2025
Pierre Anatole MATUSILA
Président Général de l’ABAKO

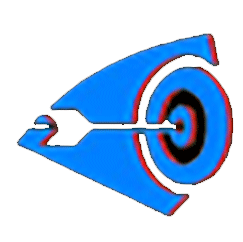



Comments est propulsé par CComment