RDC : Makala, contre-enquête sur une mutinerie qui a fini en bain de sang

Le 1er septembre, tandis que les détenus de la plus grande prison du pays se soulevaient, Kinshasa se retrouvait sous le feu des projecteurs. Embarrassées, les autorités ont promis une enquête sur ces événements, qui ont fait officiellement 131 morts, et de mettre un terme à la surpopulation carcérale. Sans beaucoup de résultats pour l’instant. Au milieu de la misère, une prison. Au cœur de la prison, la misère. Les détenus de Makala, centre pénitentiaire coincé dans un quartier populaire de Kinshasa, sont pris en étau, écrasés par la surpopulation carcérale et les conditions de détention déplorables. « Makala, c’est un autre monde », résume Marcel, un ancien détenu de 40 ans récemment libéré. Son nom, comme tous ceux qui ont accepté de nous parler de leur incarcération, a été modifié pour protéger son anonymat.
Car ce dossier est très sensible. Contacté par Jeune Afrique, un cadre de l’administration de la prison se dit « trop acculé » pour divulguer des informations. « Je ne veux pas que ça vienne de moi », prévient-il. Le directeur de Makala, Joseph Yusufu Maliki, se trouvait à l’étranger quand une mutinerie a éclaté, le 1er septembre. Il a été suspendu et n’est pas rentré au pays par peur d’être désigné comme bouc émissaire. Il avait pourtant alerté le gouvernement sur la surpopulation et le risque de débordement. Au 1er septembre, cette prison sous-dimensionnée abritait 15 000 détenus pour une capacité dix fois moindre.
Au pavillon 2, 381 détenus essaient de dormir le soir fatidique. Parmi eux, Claude, 25 ans. Il croupit à Makala depuis 5 ans, jeté en prison pour viol sans avoir pu ne se défendre ni être confronté à la plaignante. En RDC, 80 % des prisonniers sont détenus de manière préventive selon le gouvernement. Claude se dit innocent mais son sort a été scellé par un magistrat, qui lui réclamait 2 500 dollars.
Des conditions de détention catastrophiques
« On ne peut pas être libéré sans rien payer, c’est ça le problème de la surpopulation », se désole Emmanuel Adu Cole, président de la Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP), qui milite pour les droits des prisonniers. Il existe en RDC une « marchandisation de la liberté », observe Sara Liwerant, directrice adjointe de l’École de criminologie de l’Université de Kinshasa. La vie en prison est soumise à un chantage financier tout comme la menace de l’incarcération. Des magistrats, des policiers voire des avocats peuvent exiger un montant pour vous éviter la case prison. « À Kinshasa, on vous place en détention pour tout et rien. Si deux voisins se battent, on les emmène en prison », renchérit un bon connaisseur de Makala, qui pointe le rôle essentiel des magistrats dans la surpopulation carcérale.
Tout s’achète à Makala. Les plus riches vivent dans des pavillons dits VIP tandis que les plus pauvres sont entassés dans des pavillons surchargés. « Les gens dorment entrelacés comme du bois de chauffage », raconte Henri, un détenu privilégié qui moque la médiatisation des dons de matelas. « Vous allez les mettre où alors qu’il n’y a même pas de place ? »
Avant de poser son matelas, il faut acheter son emplacement. Claude a payé cher pour obtenir une couchette : 100 dollars. Il doit aussi payer « la collecte » chaque dimanche, une participation aux frais du quotidien à remettre au gouverneur du pavillon. Les prix varient en fonction de votre milieu social. Heureusement, Claude a une famille qui a fait les fonds de tiroir pour aider le fiston. « Si tu n’as pas de famille, tu ne passes pas l’année », dit-il.
« On nous vend le sac de riz, le sucre, le poulet, des choses destinées aux prisonniers », fulmine Marcel. Les repas sont maigres et dégoutants, ajoute-t-il – « si on peut appeler ça de la nourriture ! » Surpopulation, conditions de vie déshumanisantes, maladies… « C’est exactement comme ce qu’a montré Bujakera, c’est pour ça que les gens se sont énervés, trop c’est trop », insiste Marcel en évoquant les révélations de notre correspondant Stanis Bujakera Tshiamala, détenu à Makala pendant 6 mois et qui a documenté le quotidien des prisonniers en diffusant des vidéos tournées à l’intérieur de Makala, en juillet 2024.
« Il y avait comme une tension ici quand ces images sont sorties et que le ministre est venu promettre de désengorger la prison. Mais ça ne venait toujours pas et les prisonniers ont commencé à s’impatienter », se remémore Henri. Constant Mutamba, le très en vue ministre de la Justice, a accusé les magistrats congolais de remplir les prisons à mesure qu’il tentait de les vider.
Marcel se rappelle d’une réunion des prisonniers autour de leurs gouverneurs deux mois avant la mutinerie. Ils leur demandaient de parler à la direction de la prison afin de trouver une solution à la surpopulation. Le centre pénitentiaire, plein à ras bord, était devenu une véritable cocotte-minute. L’explosion était inévitable.
Le récit d’une nuit d’enfer
Marcel, Claude, Henri et Donatien dorment quand la mutinerie éclate en pleine nuit. Ils sont réveillés par des coups de feu et des bruits sourds d’objets martelés sur les portes. La prison est plongée dans le noir. « Le soir, il y a eu une coupure de courant. On ne sait pas pourquoi. C’est une zone tellement sensible que s’il y a coupure normalement, cela ne dure pas. Mais les esprits ont commencé à s’échauffer et les prisonniers ont forcé les portes d’un des pavillons les plus surpeuplés », raconte un enquêteur indépendant.
L’absence de courant coupe la ventilation. « Les gens ont commencé à étouffer au pavillon 5 », explique Henri. Les outils, couteaux, lames de rasoir circulent sans problème à Makala. « Ils ont cassé et sont sortis du pavillon. Après ils ont aidé les autres à sortir et le mouvement s’est généralisé », raconte-t-il encore. « Les prisonniers se sont fâchés ! Nous étions trop nombreux et on ne voulait pas nous libérer », renchérit Marcel.
Les portes de plusieurs pavillons tombent les unes après les autres. Sept des 11 pavillons sont vandalisés. Des flots de détenus en colère se déversent dans la cour. L’anarchie se propage à bonne distance des surveillants, qui ne sont pas présents dans l’enceinte. Makala est gérée par les prisonniers. L’absence d’encadrants, le soir, est inadaptée aux yeux de Sara Liwerant, de l’École de criminologie de l’Université de Kinshasa : « La nuit est plus angoissante, surtout quand vous êtes enfermé, que vous n’avez pas mangé et que vous n’arrivez pas à dormir. »
Une fois sortis des pavillons, certains prisonniers essaient d’escalader les murs. « Mais les militaires perchés dans les miradors aux quatre coins de la prison ont tiré sur ceux qui tentaient de s’évader », reprend Henri. « Tous ceux qui tentaient de s’évader ont été tués », affirme Donatien, un ancien détenu de 27 ans qui a préféré, cette nuit-là, rester à l’abri dans son pavillon. Marcel a fait le même choix : « Je savais que j’avais nulle part où aller, il y avait des militaires partout. »
Le difficile décompte du nombre de morts…
C’est la panique et le chaos qui auraient fait le plus de victimes. Les gens sont morts écrasés dans des mouvements de foule. Les voies de sortie des cellules étaient des trous de souris vers lesquels les prisonniers se sont rués, comme Jeune Afrique a pu l’observer dans une vidéo des événements. Dans son bilan provisoire, le ministre de l’Intérieur, Jacquemain Shabani, avait évoqué 24 morts par balles sur 129 victimes. Le bilan sera réévalué plus tard à 131 victimes.
Ce bilan ne convainc aucune des personnes que nous avons interrogées. « Il y a en a eu beaucoup, qu’on ne vous trompe pas », insiste Marcel, qui évoque le nombre de 2 000 morts. Pour Claude, ce sont 1 200 personnes qui ont été tuées. Il dit avoir aidé au ramassage des corps alignés par rangs de 100 le lendemain. Donatien évoque aussi un millier de morts et raconte sa participation à la collecte des macchabés. « Tshisekedi, regarde ça, c’est un carnage », interpelle un prisonnier dans une vidéo visionnée par Jeune Afrique où l’on voit des cadavres.
« Les détenus que nous avons interrogés disent toujours qu’il y a eu beaucoup de morts, qu’ils ont vu des camions qui venaient chercher le corps. Mais il faut faire attention au témoignage de celui qui a vu “celui-qui-a-vu” », met en garde l’enquêteur indépendant précédemment cité. Ses premières estimations tournaient autour de 150 morts avant d’être ajustées à 200. « Ce sont des chiffres conservateurs », concède-t-il.
Une autre source évoque le nombre de 300 morts, en s’appuyant sur le décompte d’une morgue. Quatre établissements mortuaires ont reçu des corps. « Mais la capacité des morgues est limitée à Kinshasa. S’il y a eu 500 cadavres à Kinshasa, cela s’est forcément senti », met en doute l’enquêteur.
En l’absence de rapport officiel sérieux, il est difficile d’établir un bilan fiable. Et de croire les autorités, qui ont multiplié les prises de parole contradictoires. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, avait d’abord évoqué un bilan de 2 morts. Jacquemain Shabani avait pour sa part pudiquement parlé de « quelques femmes violées ».
Une minoration vertigineuse alors qu’au moins 269 femmes ont été violées, selon un rapport du Fonds des nations unies pour les populations (FNUAP). « Se rendant compte que le plan d’évasion avait été réduit à néant et dans la mêlée qui a suivi, certains prisonniers se sont dirigés vers l’aile des femmes, ont brisé les portes des cellules et violé 269 détenues », précise le document. Deux détenues sont mortes.
… et du nombre d’évadés
« Soit il y a eu un carnage, soit une évasion spectaculaire », affirme Emmanuel Adu Cole de la Fondation Bill Clinton pour la paix. À l’en croire, il manque environ 2 000 prisonniers entre le recensement du 1er septembre et celui du 6 septembre. « L’appel n’a pas été fait pendant 3 jours, c’était une période de flottement. La priorité n’était pas au comptage des détenus », relativise l’enquêteur.
« Vu les tirs nourris, je ne crois pas que des gens ont réussi à s’évader. Je n’ai pas entendu un seul témoignage d’un rescapé qui vu quelqu’un s’évader », précise Henri. Des détenus ont réussi à creuser un trou dans un mur de la prison mais ils auraient été cueillis à l’extérieur par les agents de sécurité.
Une source pénitentiaire confirme qu’aucune évasion n’a eu lieu pendant la mutinerie. En revanche, plusieurs détenus ont profité des campagnes de désengorgement de la prison pour se faire la malle. C’est pourquoi le procureur, Firmin Mvonde, s’inquiétait dans un communiqué daté du 11 octobre d’une recrudescence de l’insécurité dans Kinshasa à cause des « évadés du Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa ».
Ces événements ont de quoi embarrasser le très médiatique ministre de la Justice, Contant Mutamba. Il avait qualifié la mutinerie « d’actes de sabotages prémédités », laissant entendre qu’ils avaient été organisés pour nuire au gouvernement.
Mutamba s’est rendu plusieurs fois à Makala, où il a procédé à des vagues de désengorgement spectaculaires. Les images des détenus estropiés et décharnés quittant le centre pénitentiaire n’étaient pas sans rappeler d’autres clichés, pris à la fin de la Seconde guerre mondiale, à la libération des camps de concentration. Plus de 1 000 détenus ont pu quitter la prison. Mutamba a également suspendu le transfert de prisonniers vers Makala.
De nouvelles prisons en construction
« C’est un sujet très sensible pour ce ministre », commente l’une de nos sources qui connaît bien le milieu carcéral. Le ministre, qui dit avoir reçu la mission de « redresser l’appareil judiciaire et pénitentiaire », est en guerre ouverte contre la magistrature qu’il veut assainir. C’était l’un des objectifs des états généraux de la justice qui se tenaient à Kinshasa début novembre.
Plusieurs projets de constructions de centres de détention ont été annoncés en conseil des ministres, le 8 novembre. Cinq nouvelles prisons seront bâties en urgence et d’autres seront réhabilitées dans un délai maximum de 2 ans. Des maisons d’arrêt provisoire, d’une capacité totale d’environ 4 000 places, devraient voir le jour pour les prisonniers en attente de leur procès, soit 8 prisonniers sur 10. Cependant, « plus on construit de prison, plus on incarcère » met en garde Sara Liwerant. C’est pourquoi, elle insiste sur l’importance de respecter les conditions légales de détention et de l’insérer dans une réflexion politique sur l’institution pénitentiaire.
À Makala, la vie a repris son court, presque comme avant. Le dernier recensement au 19 novembre fait état d’environ 9 500 prisonniers. « Depuis, ça a fortement été militarisé », note l’enquêteur indépendant que nous avons consulté. « Maintenant, ce sont les militaires qui viennent ouvrir les pavillons le matin », relève Henri.
La prison porte encore les stigmates des violences. La grande salle d’audience, qui a été incendiée par les détenus, n’a pas été réhabilitée et des traces de sang sont toujours visibles sur un mur d’enceinte blanc contre lequel deux détenus ont été abattus.
« Il n’y a toujours pas d’enquête », déplore Henri qui a essayé de chercher la vérité en interrogeant ses codétenus. La Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, ainsi que le ministre de la Justice, avaient annoncé des investigations. Un rapport devait être publié sous sept jours après la mise en place d’une commission dirigée par Jean-Louis Esambo, conseiller spécial du président Félix Tshisekedi en matière de sécurité. Des promesses qui sont pour l’instant restées lettre morte. Aucun responsable gouvernemental contacté n’a répondu à nos questions.
« Nous avons fait le choix de la transparence », défendait pourtant Patrick Muyaya, le ministre de la Communication, sur France 24 le 9 septembre. Trois mois plus tard, aucun résultat d’enquête n’a été publiée. Le bilan humain et les causes de la révolte demeurent flous, à l’image d’une nuit chaotique plongée dans le noir.
(Avec Jeune Afrique)

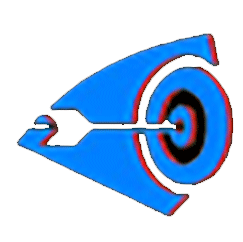



Comments est propulsé par CComment