Patrick Muyaya : « Tout le monde, en RDC, voulait ce débat sur la Constitution » Le Ministre congolais de la Communication insiste sur le bien-fondé d’un examen de la Loi fondamentale alors que le débat s’enflamme autour du risque d’un maintien au pouvoir

Depuis qu’il a officialisé son projet de réforme de la Loi fondamentale, Félix Tshisekedi entretient le flou sur ses intentions. Soupçonné par ses adversaires de vouloir briguer un troisième mandat en 2028, le chef de l’État affirme à ce stade avoir simplement « invité ses compatriotes à une réflexion sincère » sur ce texte. Soucieux de ne pas avancer trop rapidement sur un sujet aussi sensible, Félix Tshisekedi promet la mise en place d’une commission chargée de plancher sur la future mouture, laissant entre-temps à ses alliés comme à ses opposants le soin de se positionner dans ce débat. Ira-t-on vers une révision ou un changement de Constitution ? Ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya répond aux questions de Jeune Afrique.
Jeune Afrique : Le président a annoncé la mise en place d’une commission d’experts en 2025 pour étudier les « failles » de la Constitution. Le casting de cette commission est-il déjà connu ?
Patrick Muyaya : Il doit y avoir une équipe autour du président pour travailler sur la question, mais il n’y a pas encore d’indications précises. Ce sera une commission pluridisciplinaire qui comprendra des Congolais venus de différents horizons avec différentes compétences. Le texte constitutionnel régit toute la RDC, donc la mise en place d’une commission plurielle qui associerait les politiques des deux bords, de l’opposition et de la majorité, n’est pas à exclure. C’est un texte qui appartient à tous les Congolais.
Plusieurs arguments ont été avancés pour justifier une modification de la Constitution : l’article 217, le retard dans la mise en place des institutions, le mode d’élection des gouverneurs. Est-ce que vous êtes en mesure d’identifier le véritable point faible qui justifierait la réforme ?
Je ne veux pas m’appuyer sur un point précis. L’idée, c’est de réexaminer toute la Constitution. On relit les 229 articles et on voit sa structuration et ses objectifs. Ce texte a été élaboré (en 2005) dans le contexte précis d’un pays post-conflit qu’il fallait réunifier. Après quatre processus électoraux, le contexte n’est plus le même, on n’a plus de belligérants comme en 2003-2006.
J’ai discuté avec un professeur de droit. Il me dit que, normalement, comme on a adopté le droit Ohada [Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires], les mandataires des entreprises publiques ne devraient plus être nommés par le président de la République. Mais ce n’est pas ce que stipule la Constitution !
Autre argument. La RDC est entourée de neuf voisins, dont six parlent anglais. Est-ce que, aujourd’hui, le français doit rester la seule langue officielle de la RDC ? Est-ce qu’il n’y a pas besoin d’adopter plutôt l’anglais ? Ne peut-on faire de nos quatre langues des langues officielles, comme l’Afrique du Sud, qui en a onze ? Il y a aussi la question de la double nationalité, qui a toujours été voulue de tous, mais que l’on n’a jamais eu le courage de mettre en œuvre.
Personne ne peut refuser l’opportunité d’un débat sur la pertinence de la Constitution. On peut comprendre qu’il y ait des appréhensions chez certains, c’est normal, mais je pense que le président, élu avec 70 % des suffrages, a la légitimité nécessaire pour amorcer ce débat.
Est-ce le bon moment ?
Le chef de l’État, lors de son discours sur l’état de la nation [le 11 décembre], a précisé son idée. L’objectif principal est de lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Je ne pense pas qu’il y ait meilleur argument.
La question qui cristallise les débats, c’est le risque d’un maintien au pouvoir de Félix Tshisekedi si une nouvelle Constitution remettait le compteur de ses mandats à zéro. Partira-t-il à l’issue de son second mandat en 2028 ?
Nous achevons tout juste l’année 2024, le président est à peine élu, il nous reste quatre ans. Le plus urgent pour nous est la mise en œuvre de sa politique et de ses engagements. Le président de la République a dit, à Lubumbashi [en novembre], qu’il ne voulait pas s’éterniser au pouvoir, qu’il souhaiterait pouvoir circuler librement dans le pays avec toute sa famille. Il a donc déjà donné des indications.
On ne peut pas réduire la pertinence de ces débats à l’article 220 de la Constitution [qui limite le nombre de mandats présidentiels], sur lequel beaucoup de gens se focalisent. Le débat constitutionnel qu’il a lancé s’impose. Tout le monde le voulait, et depuis bien longtemps.
Le président est bien placé pour savoir ce que peut donner une mobilisation de l’opposition contre une réforme constitutionnelle ou un hypothétique troisième mandat…
Il y a un an, nous sommes allés aux urnes. Faisons le décompte et le bilan des forces qui sont allées aux élections et vous aurez la vraie valeur de l’opposition. Veut-on faire un front anti-Tshisekedi ou un front anti-réflexion pour voir si l’on peut réviser ou changer de Constitution ? Moi, je perçois une forme d’acharnement contre la personne du président de la République.
Après l’annulation de la rencontre prévue le 15 décembre entre les présidents Tshisekedi et Kagame, faut-il considérer que le processus de Luanda est dans l’impasse ?
Le processus est dans l’impasse du fait de la volonté délibérée du Rwanda. En refusant de participer à cette tripartite et, donc, d’honorer sa parole et le travail du facilitateur, le président rwandais a démontré que c’était lui l’obstacle au retour de la paix dans l’est de la RDC. Il a fait le choix du M23 plutôt que celui de la paix. Il a démontré qu’il en était le géniteur et le parrain. En signant cet accord, il aurait tué sa créature, celle qui lui sert de voie de survie à travers le pillage systématique de nos ressources.
Aujourd’hui, la balle est dans le camp à la fois du facilitateur, des Nations unies, mais aussi de tous les pays qui soutiennent le processus diplomatique.
Comment la RDC compte-t-elle s’y prendre pour démanteler les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) ?
Au-delà de l’engagement que nous avons pris, nous savons que les FDLR sont un vilain prétexte pour justifier une guerre dont les motivations sont économiques. La démonstration est claire avec ce qui se fait à Rubaya et sur d’autres sites miniers. Les Rwandais ont successivement évoqué la question des réfugiés, celle des FDLR, celle d’un prétendu discours de haine. Nous voulons les conduire au bout de leur logique belliqueuse et chacun sera confronté à ses responsabilités. Des observateurs ont été déployés pour veiller au respect de ces engagements.
Le retrait des troupes rwandaises doit-il précéder le démantèlement des FDLR ?
Il existe un plan opérationnel convenu par les états-majors des deux bords. Il faut laisser cette question aux techniciens.
Les autorités rwandaises estiment que la résolution définitive du conflit ne peut passer que par un dialogue direct entre Kinshasa et le M23. Que répondez-vous ?
Pourquoi discute-t-on avec le Rwanda à Luanda s’il n’est pas lui-même partie au conflit ? Pourquoi le ministre des Affaires étrangères parle-t-il de mesures défensives dans ce processus ? Il ne faut pas considérer que le M23 existe sans le Rwanda ; celui-ci ne peut pas s’en dissocier en exigeant un dialogue direct entre nos autorités et ce mouvement. Il en est le porte-parole, comme il l’a été avec d’autres mouvements, tels que le CNDP (Congrès national pour la défense du peuple) ou le RCD (Rassemblement congolais pour la démocratie, pro-Rwanda).
Les propos du ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, qui a promis, fin novembre, une « prime » pour l’arrestation de Paul Kagame ne nuisent-ils pas au processus de médiation ?
Il faut laisser le ministre de la Justice faire son travail tel qu’il le fait. Je n’ai pas de commentaire particulier à faire, à part de constater que le Rwanda cherche des prétextes là où il ne faut pas en trouver. Il y a une volonté politique claire de la RDC de parvenir à la paix, c’est pour cela que nous poursuivons le processus de négociation. Il ne faut pas chercher à se réfugier derrière des faux-fuyants alors que nous sommes en train de faire aboutir le processus de médiation.
Début décembre, le Ministre de la Justice a aussi promis de faire appliquer la peine de mort pour les kuluna (gangs de jeunes ultraviolents à Kinshasa), ainsi que pour les membres de l’AFC (Alliance Fleuve Congo, la plateforme politico-militaire dont fait partie le M23). La RDC va-t-elle vraiment procéder à ces exécutions ?
Il faut regarder le contexte dans lequel la levée du moratoire a été décidée. Nous avions une réalité de terrain qui était que des officiers faisaient le jeu de l’ennemi et trahissaient [leur pays]. Pour ce qui est du reste, il y a une procédure judiciaire qui doit suivre son cours. Si cela doit aboutir à l’exécution de la peine de mort, il faut s’assurer que toutes les étapes du processus ont été respectées au préalable. Notre volonté est d’arriver à sanctionner ceux qui se compromettent avec l’ennemi.
Pour ce qui est du banditisme urbain, le président a affirmé que la loi doit être appliquée dans toute sa dimension. Il faut laisser la justice suivre son cours et voir quelles orientations cette dernière prendra.
Le ministre de la Justice a été beaucoup plus affirmatif… L’application d’une telle mesure ne nuirait-elle pas à l’image de la RDC ?
Le ministre de la Justice a son style et sa manière de conduire un certain nombre de questions qu’il faut lier à leur contexte précis. Dans l’administration de la justice, il y a le procès et le verdict. Le ministre de la Justice veut, à mon avis, dire la fermeté et le caractère intraitable du gouvernement. Mais il ne peut pas anticiper non plus le résultat d’un procès. Il faut suivre chaque procès jusqu’à son aboutissement, et à ce moment-là, nous verrons comment la justice a été rendue.
Craignez-vous que les États-Unis cessent de s’investir dans le processus de Luanda, avec l’arrivée au pouvoir de Donald Trump ?
Il a d’abord été élu pour régler les problèmes des Américains. Dans le cadre de la relation privilégiée que nous avons avec les Etats-Unis, nous allons continuer à discuter avec la partie américaine, qui a été d’un fort soutien dans le processus de Luanda, notamment à travers sa directrice du renseignement, Avril Haines.
Nous espérons que les États-Unis pèseront encore plus dans ce dossier pour que nous parvenions à la paix, et que nous pourrons consolider nos rapports économiques. Le président élu Donald Trump a pris l’engagement de contribuer à mettre fin à des guerres et nous espérons que la guerre que nous impose le Rwanda fera partie de son agenda.
Jeune Afrique

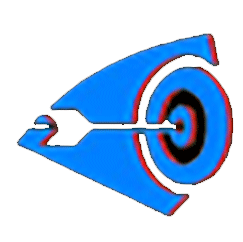



Comments est propulsé par CComment